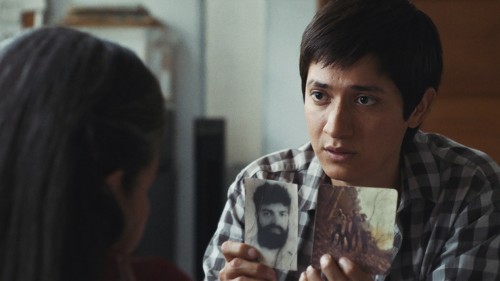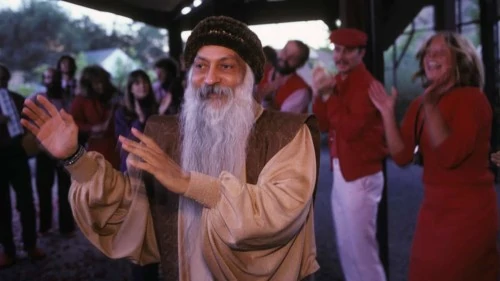Espace, images, spectateurs, actrices : le salon de l’érotisme déploie une expérience qui n’a rien à envier au cinéma et aux performances mettant en scène la relation entre le "performer" et le spectateur. Avec, au bout du compte, une étrange expérience : celle de succomber à une image, et plus précisément à une actrice jouant à l’automate.