
« La Sainte Famille des Cahiers du cinéma » : Entretien avec Olivier Alexandre
Avec « La Sainte Famille des Cahiers du cinéma », Olivier Alexandre signe un passionnant essai de sociologie du cinéma sur le fonctionnement des Cahiers et, par extension, de la critique française.
Entretien avec Olivier Alexandre autour du livre « La sainte famille des Cahiers du cinéma »
L'intérêt que nous portons pour la sociologie et l'anthropologie culturelle trouve dans cet entretien avec Olivier Alexandre un nouveau prolongement. Cet intérêt était au départ au moins double. Il nous permet d'abord de prendre en compte l'expérience spectatorielle dans un cadre plus large et non plus réduit à la simple relation entre un regard et l'écran. À l'heure où les cinéphiles se déchirent autour de débats stériles (Netflix vs. la salle de cinéma, par exemple), nous rappelions toute la richesse d'une existence de spectateur nomade, qui nous a mené jusqu'au salon de l'érotisme. Pour nous qui voulons nettoyer notre regard d'un maximum de clichés et d'archétypes, comprendre les postures du spectateur et ce qui les altère est décisif puisqu'elles participent au processus même d'écriture. Nous avons ainsi créé la catégorie "Histoires de spectateurs" qui n'est pas sans liens avec ce retour vers le spectateur. Ce recentrement que permet la sociologie, qui fonctionne en même temps comme un décloisement, est plus que jamais compatible avec la pratique d'écriture que nous cherchons à mener : expérimenter et raconter l'histoire des affects. D'autre part, la sociologie permet d'éclairer sous un autre jour le milieu de la critique de cinéma. La sainte famille des Cahiers du cinéma s'impose comme un livre exemplaire qui permet de rebondir sur de nombreux sujets comme autant de perches que nous souhaitions tendre à Olivier Alexandre. Pourquoi ? Parce que la confusion (que l'auteur souligne avec précision) est encore grande entre les différentes pratiques de la critique tout comme le dénigrement des revues en ligne s'avèrent toujours aussi injustifié. Nous voulions surtout confronter notre approche de l'écriture qui ne se soutienne ni du jugement critique, ni du savoir académique, à la lecture sociologique d'Olivier Alexandre. Peut-on se débarrasser aussi facilement du jugement ? Notre volonté de reprendre la pratique du "maître ignorant" de Jacques Rancière s'opère-t-elle sans contradictions (des contradictions qu'Olivier Alexandre interroge à nouveau dans cet entretien) ? Car c’est du savoir comme paradigme conditionnant une relation intersubjective de transmission, reposant sur le postulat d’une inégalité des intelligences ouvrant à une hiérarchie, un système de domination, une progression linéaire sous la direction d’un maître, qu’il est toujours question de se débarrasser. Et ce, pour une pratique émancipée des savoirs (entendus ici comme contenu circulant entre nous) sous la condition d’une égalité des intelligences qui est celle en laquelle nous croyons au Rayon Vert. Cet entretien répète alors certainement que cette volonté fait irrémédiablement face à des difficultés lorsqu'il s'agit se détacher des processus de distinction et de légitimation qui animent tout projet critique.
Les revues papier, la cinéphilie et le capital symbolique
Comment en êtes-vous venu à écrire ce livre ? Aviez-vous ressenti le besoin de répondre aux limites et aux problématiques qui touchent aujourd'hui la critique de cinéma ?
Ce livre a commencé durant mon travail de thèse sur le cinéma français. J'avais interviewé de nombreux critiques avec l'idée qu'ils étaient partie prenante d’un ensemble qu’on désigne confusément comme « l’exception culturelle » ou le « modèle français », i.e ce système d'organisations privées, publiques, parapubliques reposant sur une coopération entre le cinéma et différents secteurs (télévision, finance, administration publique, etc.). Rapidement, je suis arrivé au constat que les critiques que je rencontrais étaient confrontés à d’autres enjeux, notamment en termes d’espace social. La critique est un « petit monde », qui se pense relativement autonome, mais qui dans les faits entretient des liens constants avec, outre le cinéma, l'université, le journalisme, les revues d'art et la littérature. J’ai donc décidé de faire un pas de côté. Après un livre consacré au modèle du cinéma français, La Règle de l'exception(1), j’ai pris le temps d'effectuer un travail spécifique sur la critique française à travers les Cahiers du cinéma.
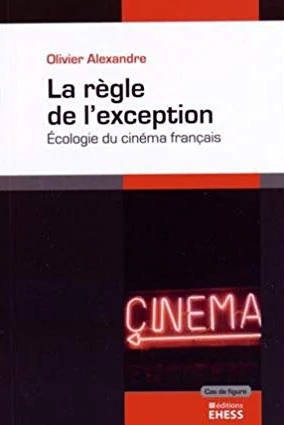
Il ne s'agissait pas tant d'écrire sur les Cahiers du cinéma parce qu'elle serait la revue la plus légitime, mais de comprendre et d’analyser cette place étrange du critique à l’égard de la culture et de la critique dans l'histoire intellectuelle de la France. Je veux dire par là que la place du critique est socialement indéterminée, floue, presque chancelante alors même que la tradition critique est centrale dans l'histoire intellectuelle du pays, avec des figures comme Diderot, Sainte-Beuve, Baudelaire, Bazin, Debord, Daney, ou même Walter Benjamin, qui a écrit une partie de son œuvre vagabonde – et c’est un point essentiel – en France. Ces critiques, qui étaient aussi et non exclusivement des écrivains, ont fait du déplacement, à la fois géographique, social et intellectuel, un principe de vie. Ce n’est pas anodin et pour mieux s’en rendre compte, on peut le comparer à la notion d’auteur, qui paradoxalement ou ironiquement, en constitue le pendant, le second terme d’un binôme, puisqu’il est de coutume de considérer que l’auteur ne va pas sans son critique. Or, comme l’a analysé Foucault, la notion d’auteur repose sur des logiques d’assignation, d’identification, de territorialisation du sens. Le critique à l’inverse procède par déplacements, mélanges, il pratique une forme de nomadisme du sens. Mon hypothèse est que dans cet écart se joue le je-ne-sais-quoi qu'on appelle « l’esprit français » ou « l’esprit critique », qui n’est pas ou pas uniquement un cartésianisme, mais qui se rapporte à une forme sociale irréductible à la discussion, d’ailleurs souvent violente, qui se propage par effets de houle du salon des Lumières à la Cinémathèque de Paris. De ce point de vue, et c’est la thèse que je défends dans le livre, on ne peut pas distinguer deux critiques, l’une qui serait savante, l’autre qui serait populaire ; l’une majeure et l’autre mineure ; l’une littéraire, l’autre de commentaire, car elle sont de mon point de vue deux expressions indissociables d’un même phénomène.
Il m’a semblé que cette unicité n’avait pas toujours été bien perçue ou décrite. On lui a souvent préféré une dualité ordinale, séparant le bas du haut. La critique est en effet toujours saisie de manière dissociée : soit on s'intéresse à la critique savante et donc à des milieux professionnels : les critiques d’art, les journalistes, les critiques littéraires, etc. Soit on s'intéresse à la critique ordinaire – celle dont tout le monde serait capable a priori de faire usage – sous la forme qu'elle prend dans des groupes sociaux assez distants des institutions et des milieux culturels consacrés, comme des groupes populaires ou composés d'amateurs. Par extension, on retrouve un même découpage dans les formes de la critique : l’une se produirait sur scène, dans l’espace public ; l’autre serait l’affaire des discussions privées. Dans mon livre, j'essaie à l’inverse de décrire leur articulation, qui révèle un rapport des critiques au monde qui les entoure passant essentiellement par l’acte de parole.
Avez-vous reçu des réactions de la part des rédacteurs des Cahiers du cinéma, actuels ou passés, de revues similaires ou de personnes n'ayant pas souhaité collaborer avec vous ? Vous rappelez que la démarche qui soutient vos travaux (la sociologie et l'anthropologie culturelle) n'a jamais été bien accueillie par la critique, quand elle n'en est tout simplement pas exclue.
Je m'attendais soit à des critiques virulentes, soit à un silence total. Je n'ai eu ni l'un, ni l'autre. Je sais que le livre circule, qu’il est lu, et en même temps, je n'ai eu de réactions du milieu que par voie privée. Positives ou négatives, mais jamais publiques. Il n'y a pas eu de réelles prise(s) de position, peut-être parce qu’il s’agit comme je le disais d’un pas de côté, d’une critique de 3è degré comme j’essaie de l’expliquer dans l’introduction. Il faudrait par ailleurs évoquer les liens, ou leur absence, entre le cinéma et la sociologie. Le cinéma est apparu très tôt en France, de même que la sociologie, et d’une certaine façon il partage une même généalogie, celle de l’objectivité, d’une objectivité presque républicaine. Durkheim et les frères Lumière sont des contemporains. Aurait dû s’instaurer un rapport de fraternité, comme le laissaient entendre les premiers travaux d’Edgar Morin ou de Roland Barthes, qui peuvent d’ailleurs sembler déjà tardifs, puisqu’ils sont le produit de l’après seconde guerre-mondiale. Pourtant, alors que l’anthropologie visuelle a su introduire un trait d’union durable, la sociologie et le cinéma s’en sont tenus à un rapport de rivalité, de concurrence, et d’ignorance. Si l’on se réfère aux Cahiers du cinéma, Roland Barthes, Christian Metz, Michel Foucault (pour ne citer qu'eux), furent invités, de très rares papiers citent Bourdieu et Passeron. Mais plus profondément, ces références sont toujours traitées de la même manière, qui est symptomatique du fonctionnement de la revue : d’une part, ces auteurs sont présentés comme des exceptions, les représentants d’une avant-garde, d’autre part leurs concepts sont pris dans un rapport de déplacement, de glissement. Or, ce qui se rapporterait à une faute du point de vue académique vaut ici vertu.
Que pensez-vous du travail accompli jusqu'ici par le binôme Delorme/Tessé à la tête des Cahiers du cinéma ?
L'objectif de La Sainte Famille des Cahiers du cinéma n'était pas de distribuer des bons ou des mauvais points. Ce n'est pas le propos et je n'ai pas compétence à le faire. L'idée était plutôt d'appréhender les Cahiers du cinéma comme une organisation au long cours, et non pas à travers une série de périodes historiquement déterminées, comme a pu le faire par exemple Antoine de Baecque. Envisager comme je le fais l’organisation comme un cadre d’activité permet de mettre en lumière les effets de structure et de pesanteur qui transcendent les différentes périodes. On pourrait reprocher à mon livre de nier l'évidence des ruptures aux Cahiers et au sein même de la critique. Mais pour moi, c’était un point de départ, une hypothèse de travail. L'idée était de neutraliser les effets de perspective et le récit que se donne la revue à elle-même pour mieux penser ce qui se jouait souterrainement entre les personnes, indépendamment de ce qu'elles peuvent penser à un temps donné. Les Cahiers du cinéma, et la critique en général, est un espace de production de critiques à flux tendu, où chacun distingue et se distingue : les critiques de ceux qui ne sont pas critiques ou qui le sont moins – idée qui occupe une place très importante dans l'histoire de la revue ; ainsi qu’entre les différentes rédactions, voire les critiques d’une même rédaction puisqu'il s’agit constamment de prouver sa valeur en dévoilant celle des films. Ce qui nous donne une distinction entre des groupes de critiques à un moment donné (les Cahiers contre Positif, Les Inrocks, Libération...), des distinctions entre les groupes de critiques des différentes périodes des Cahiers du cinéma. On a ainsi un diamant, à partir duquel une série d'oppositions sont activées, projetées et actualisées.
Plus globalement, pensez-vous que les enjeux que tentent de poser les Cahiers ou d'autres revues, la manière dont ils segmentent la production et la hiérarchisent, soient pertinents, aujourd'hui, pour penser, expérimenter et transmettre un discours sur le cinéma ?

Le terme que je retiendrais ici est celui de hiérarchie. Au tournant des années 1970-80, notamment dans un texte de Pascal Bonitzer, la revue opère un retour vers les sentiments, le sujet, l’instance individuelle, un "retour au film" qui introduit une ambiguïté profonde dans le rapport de la critique aux films et plus généralement à la culture (les séries, les jeux vidéos, la télé-réalité, le sport). Cette ambiguïté sera équipée intellectuellement, vingt ans durant, par Jacques Rancière à partir d’une question : quelle est la place moralement acceptable du jugement et du critique dans une perspective historique d’émancipation ? Une position classique, presque stéréotypée, revient à envisager le critique comme un passeur. Mais que signifie être un passeur à partir du moment où le jugement n'est plus rapporté dans un rapport d’autorité, mais relève de la subjectivité ? D’un axe vertical, la critique est rabattue sur un axe horizontal. Elle est comme nivelée, sans autre dignité que l’opinion de x ou de y, qui est l’idéal moral d’une plateforme comme Youtube. Dans cette configuration, le travail de Rancière offre une sortie par le haut d’une impasse historique pour le critique « à la française », et ce en deux temps. Avec Le maître ignorant(2), les critiques ont pu s’identifier à un nouveau récit, celui d’une figure héroïque, vertueuse car sacrificielle, qui donne les outils et met en place les dispositifs permettant de penser sans lui. L’autorité perdure mais elle est réduite et transitoire. Avec Le Partage du sensible(3), Rancière indique une direction à suivre : celle d’une démocratisation des représentations et de ses objets, le critique pouvant ainsi défendre et œuvrer à leur modernisation ainsi qu’au progrès de leur diffusion. L’ambigüité de la critique aujourd’hui, et aux Cahiers du cinéma depuis trente ans, me paraît liée à cette orientation qui, en réalité, revient à tenir d’une seule main deux programmes : l’émancipation comme projet et l’émancipation comme état. Alors que la médiation a intégré les plaquettes universitaires, le maître ignorant ne peut être qu’en sursis, une ultime péripétie de l’histoire. C'est une démarche louable, donc acceptable moralement, mais elle flirte avec l’aporie, la contradiction, à un rapport d’impossibilité. Je ne suis pas sûr que la critique ait tranché sur ce point alors qu'elle y est pressée de toutes parts par les réseaux sociaux, qui la confronte au double défi de la masse et du décloisonnement. Le critique ne bénéficie plus d’un accès privilégié à l’espace public, pas plus qu’aux artistes. Quelle place désormais occupe-t-il ? Doit-il se faire entendre ou faire le pari de Kafka ? De ce point de vue, il est possible que l’heure soit à celle d’un aggiornamento de la critique. Il n’a à ma connaissance pas eu lieu. Par effet de retard, par avance, ou alors parce qu’il est impossible.
Comment expliquez-vous que le modèle actuel de la critique de cinéma et le fonctionnement structurel qui l'accompagne continuent aujourd'hui à tenir ? Entérineriez-vous l'idée que cette "bulle" de la cinéphilie française (la cinéphilie institutionnelle, comme la nomme si bien Laurent Jullier) ne serait au fond qu'une illusion, un "capital symbolique fantôme", et la cinéphilie une pratique réellement marginale concernant quelques milliers de personnes tout au plus ?
Le livre de Jullier et Leveratto opère des clarifications importantes, notamment celle relative à la cinéphilie, dont l’amplitude excède de beaucoup les simples emblèmes que sont les revues, la cinémathèque, les cinémas du quartier latin, etc. Le livre de De Baecque et Toubiana, La cinéphilie : invention d'un regard, histoire d'une culture(4), en présente une histoire localisée, paradoxalement atypique, concernant un petit nombre de personnes socialement déterminées (hommes, blancs, cultivés et ayant fait des études, tout à la fois scolaires et en rupture de ban, bourgeois et dans un entre-deux social). Truffaut incarne l'exemple parfait de cette ambiguïté, des positions (sociales) et du portrait (historique) de la cinéphilie dite savante. Si l’on reste rivé sur cet idéal-type de la cinéphilie, il est impossible d’appréhender les effets de brouillage introduits ces dernières années par l’abondance de l’offre, son internationalisation, le téléchargement et le streaming, le décloisonnement de l’information et de l’espace public.
On pourrait dire que votre livre s'intéresse au fond à la question de l'écriture sur le cinéma. Celle-ci serait inséparable des processus de distinction qui laisseraient des traces à l'intérieur des textes. Vous montrez bien comment cela fonctionne aux Cahiers du cinéma. Dans un numéro récent où ils publiaient un vieil entretien avec Jacques Rivette, ils avaient mis en exergue une phrase de ce dernier : "Parler du film en tant que film"... Finalement, l'écriture Cahiers parlerait-elle moins du film lui-même que du pouvoir symbolique et imaginaire de la revue et de ses rédacteurs ?
La Sainte Famille des Cahiers du cinéma parle moins de l'écriture elle-même que d'un sens pratique, oral ou écrit, relatif à la pensée graphique définie par Jack Goody et l’anthropologie culturelle. Il s'agit de laisser une trace à travers les textes, mais aussi des discussions, des conférences, des échanges structurées à la manière d’un écrit. J'entends par là que chez les critiques la production du texte est antérieure et postérieure à l’acte d’écriture. Pour le critique en tant qu’individu, mais aussi pour la critique au sens d’activité. Car la production d’une analyse s'opère en rapport à ceux qui ont précédés et ceux qui vont suivre. Un critique arrivant tout juste aux Cahiers du cinéma maîtrise très imparfaitement cette histoire. Mais il sait qu’elle existe et va progressivement s'imprégner de l’esprit patrimonial de la revue, chercher à s’en émanciper et ce faisant, à l’alimenter. C’est aussi en cela que la critique correspond à un entrepreneuriat du goût.
Le cinéphile a-t-il toujours besoin, en premier lieu, d'un prescripteur pour l'orienter dans l'offre de films ? Pourrait-on s'en passer ? Si oui, pensez-vous à des solutions alternatives ?
On arrive rarement devant un film par hasard car il y a des dispositifs personnels, interpersonnels, ou simplement marchands, comme les étoiles ou les algorithmes, qui motivent à voir tel film ou regarder telle série. Le bouche à oreille demeure le prescripteur le plus puissant. La prescription de la critique reste quant à elle faible. Les données sont stables : seuls 7-8% de personnes présentes dans une salle de cinéma le sont suite à la recommandation d’un critique. Ce constat, désespérant au regard d'une théorie des effets forts de la critique, révèle une autre facette. La critique est comparable à la ruse métis des Grecs. Elle se faufile, passe entre les films, change d’une page à l’autre, s’affirme, puis se renverse. On lui reproche d'être injuste, partiale, inconstante alors que c'est sa raison d'être. Elle est mobile et est en cela bien plus pratique et accomodante que la raison. La critique ne se confond en rien avec la logique ou la philosophie analytique à l’égard de laquelle elle manifeste une certaine surdité.
Que pensez-vous des autres revues papiers "commerciales" à disposition du cinéphile, et en particulier des nouvelles venues comme La Septième Obsession, Carbone ou Revu & Corrigé ? En analysant de plus près la façon dont elles ont vu le jour, on constate qu'il y a un dénominateur commun, du moins pour Carbone et Revu & Corrigé : elles ont brassé des fonds importants via des campagnes de crowdfundings et récolté dans la foulée un capital symbolique fort. Il semble que l'importance de ce capital soit le facteur déterminant de la réussite du projet.
Nous sommes ici au carrefour de différentes questions, qui touchent toutes à la manière dont la critique se redéploie, entre essor (le renouveau du fanzine, les blogs, les commentaires, les revues en ligne, etc.) et appauvrissement. Les lignes d’opposition entre l'amateur et le savant, la niche et le mainstream, le bon gout et le mauvais genre sont passées à la centrifugeuse. Mais on se déporte ici sur un enjeu plus large : celui des effets de recompositions culturels notamment dans leur rapport à la stratification sociale, qui apparaît comme plus internationale, plus marquée par les différences d’âge et l’affirmation des cultures de niche que par le passé, bien au-delà des seules revues cinématographiques.
La crise de la presse papier, on le sait, inquiète les principaux acteurs du milieu. Quelle est votre position par rapport à celle-ci ? Pensez-vous, à l'instar d'un récent édito de Stéphane Delorme dans le numéro d’octobre 2018, qu'elle doit continuer à faire autorité et garantir un "socle de vérité" par rapport à Internet et aux fake news ?
La crise de la presse papier est indéniable. On compte quelques réussites, telles que Médiapart ou le New York Times qui a redressé la barre de manière spectaculaire, pour de nombreux échecs chez les pure players. Historiquement, la critique n'a jamais été une activité rentable, ou sinon très marginalement. On est plutôt dans le registre de la valeur symbolique : des investissements coûteux mais profitables pour l'image. L’ambiguïté des Cahiers du cinéma est que la revue est passée d'une position de marge, de contestation, à une position établie. Mais cet anoblissement est de façade. On a certes rétrospectivement l'impression que la revue comptait et a compté, mais à l'époque où Truffaut et Godard écrivaient, elle était diffusée à 5.000 exemplaires, entre 15.000 et 20.000 aujourd’hui, alors que dans le même temps la consommation audiovisuelle a explosé. Le changement de statut de la revue est donc plus d’ordre subjectif qu'objectif. Elle concerne quelques anciens rédacteurs de la revue, essentiellement les plus connus, plus que l’organisation elle-même dont le tirage et l’influence restent en réalité très limités. Certains critiques des Cahiers du cinéma ont pu chercher à faire autorité, alors qu’ils n’en ont pas l’audience ni les moyens. Ils ne feront ni ne déferont la carrière d’un film, et sûrement pas le cours de l’action de Netflix.
Toujours dans le même édito, Stéphane Delorme a réaffirmé son attachement au papier tout en critiquant à nouveau les médias virtuels. Cette absence de transition vers internet est-elle une erreur de la part des Cahiers ?
Les Cahiers du cinéma ont en fait essayé très tôt, entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, de mettre en place une activité sur internet via leur site web. Certains rédacteurs qui ont compté dans l'histoire de la revue, comme Emmanuel Burdeau ou Thierry Lounas, se sont investis dans ce projet. Cet engagement n'a pas rencontré le succès escompté. On pourrait y voir par extrapolation la confrontation entre deux logiques, celle de la critique sous ses différentes formes, et celle des réseaux sociaux et des plateformes, qui radicalisent et vident de sa substance le projet historique de la critique.
En tant que chercheur, vous intéressez-vous à la présence sur les réseaux sociaux des critiques de cinéma (plus précisément ceux qui gagnent leur vie avec cette activité) et aux discussions auxquelles ils participent ? Des cercles bien définis de cinéphiles se sont construits et discutent entre eux sur Facebook ou Twitter. Il semble que soit là que s'acquiert, se joue ou s'entérine aujourd'hui une partie du fameux capital symbolique que vous décrivez.
Oui, absolument. Je n'en ai peut-être pas assez rendu compte dans La Sainte Famille des Cahiers du cinéma, notamment parce que je n'ai pas fait le travail de collecte des échanges. Il y aurait deux façons d'utiliser ces discours. La première consisterait à considérer les publications sur les réseaux sociaux comme des outils d'objectivation entre deux discours critiques, comme l'a fait mon collègue Michael Bourgatte dans un article où il tente d'objectiver la différence entre la critique savante et la critique amateure/populaire. La seconde manière est de s'intéresser au monde numérique, à l'univers du digital et aux réseaux sociaux comme des illustrations de la formation et de l'existence du monde de la critique, un monde qui se côtoie, discute, s'approuve ou se critique. Ce sont des orientations éclairantes à bien des égards.
Les revues en ligne
Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les revues de cinéma en ligne ?
Cette question mériterait une enquête en soi, que je n'ai pas menée pour La Sainte Famille des Cahiers du cinéma, mais différents collègues travaillent actuellement sur ces questions. Attendons leurs publications !
Vous décrivez le phénomène des articles "pissés à la chaîne" par des rédacteurs en quête de reconnaissance symbolique. Est-ce qu'il se reproduit dans le cas des revues de cinéma en ligne ?
"Pisser de la copie" est une expression empruntée à l’univers de la littérature, du journalisme et des lettres : il s’agit de produire du texte rapidement, ce qui représente un enjeu majeur pour les critiques. Cela leur permet d’asseoir leur statut au sein de la revue et de gagner de l'argent, puisque l'essentiel d'entre eux sont payés à la pige, dans les 50 euros pour une critique long format.

Pour qu'une revue papier ou en ligne "réussisse", faut-il impérativement trouver une place dans cet enchevêtrement sociologiquement déterminé et déterminant tel que vous le décrivez dans votre livre ?
Tout type d'entrepreneuriat est incertain, périlleux, et implique de trouver en soi et avec les autres des ressources autres que l'argent. Paradoxalement, le milieu de la culture a fourni plusieurs exemples d’entrepreneuriat réussi. On peut penser en France aux cinémas Utopia, qui sont devenus un réseau de salles Art & Essai établi après avoir traversé vingt années de difficultés économiques, ou encore à L’Association dans la bande dessinée, d’où sont nés des succès comme Persepolis. Le succès pour de tels acteurs peuvent aussi recouvrir une part de malchance, car la gestion de l’abondance d'argent et d’audience nécessite d’autres savoir-faire. Ces entreprises sont très fragiles et posent la question de l'indépendance. J'ai consacré un ouvrage à cette question avec deux collègues, Sophie Noël et Aurélie Pinto, Culture et (in)dépendance. Les enjeux de l’indépendance dans les industries culturelles(5), qui retrace le trajet de quelques-unes de ces trajectoires entrepreneuriales, dont celle d’Eric Rohmer, qui reste un modèle.
Comment comprenez-vous l'apparition des nouvelles techniques de promotion sur internet et de la langue qui l'accompagne ? Pensez-vous qu'elles portent vraiment leur fruit ? Car c'est bien évidemment tout le secteur culturel qui se prend au jeu par peur d'être dépassé.
On a souvent parlé de révolution numérique. Je pense qu'il faut être très prudent avec l’expression « révolution », qui n’est bien souvent qu’un élargissement, et dans le même temps être capable de la prendre au pied de la lettre. La révolution du livre, la révolution française, la révolution du numérique n’ont pas le même centre de gravité. La Révolution française marquait la création d'un espace publique investi, porté et identifié à la bourgeoisie – c'est la thèse même d'Habermas. La Révolution numérique est la promesse d'un décloisonnement de l'espace public par la Silicon Valley : l'enjeu ne situe plus dans le contenu mais dans la mise en réseau des informations. Cette idée était déjà présente à l'époque des Lumières – les premières critiques de Diderot sur les Beaux-Art, où il est question de mettre en circulation des jugements auprès de la bonne société qui n'avait pas l'occasion de se rendre dans les différents salons – où le point d'appui était le philosophe, la pensée, le bourgeois, ce qu'on a appelé les "publicistes". Mais dans le cas de la Silicon Valley, le point d'appui est tout entier le dispositif technique. Pas le contenu. Cela renvoie à la confusion que j'évoquais plus haut au sujet de la critique. Vous évoquiez l’édito des Cahiers. Il est probable qu’un malentendu (qui est peut-être une volonté de ne pas entendre) sépare les critiques, qui restent attachés au programme des Lumières, du projet de société porté par la Silicon Valley. Les critiques doivent-ils aujourd'hui faire des conférences TED ? Doivent-ils s'interroger sur les canaux de la critique plutôt que sur son sens ou son contenu ? À s'interroger sur l’irréductibilité du fond et de la forme de la critique et, du coup, à penser leur propre activité critique sur la base des outils, des dispositifs et des relais dont ils disposent ? Je ne sais pas si ce travail est fait mais cela semblerait le premier pas vers l’aggiornemento de la critique.
Vous parlez à de nombreuses reprises dans votre livre, et de manière critique et nuancée, de l'idée de communauté. Vous montrez que la rédaction des Cahiers du cinéma est une communauté fragile et hiérarchisée. De notre côté, en tant que communauté virtuelle, il nous est plus facile au Rayon Vert de supprimer ces hiérarchies et les marqueurs sociaux puisque seuls comptent pour nous les textes (qui se valent les uns les autres). Voilà une idée qui semble s'opposer aux pratiques de la critique. Pensez-vous que ce mode de fonctionnement puisse un jour se généraliser ? Ceci pourrait signifier quelque part la fin du pouvoir symbolique de la critique du type Cahiers et de ses pratiques de distinction.
On pourrait défendre l’idée que les entrepreneuriats culturels se forment et évoluent d'une manière assez semblable. Des impressionnistes à la Nouvelle Vague, en passant par la dernière génération des Cahiers, il s'agit toujours d'un groupe de pairs, où le statut d’égaux qui constitue le principe fondateur implicite des débuts est tendanciellement remis en cause par des effets d’asymétrie. Certains vont travailler plus que d'autres ; obtenir plus de reconnaissance ; avoir plus d'ambitions ; d’opportunités ou tout simplement de chance. Au fur et à mesure des années et du développement du collectif, des contraintes croissantes vont apparaître. Il s'avère difficile d'y échapper, sauf à placer la parole au cœur de l'activité. J'en reviens au réseau Utopia, qui est un excellent modèle. Contrairement à l'image qu'ils peuvent se donner, ils n'ont jamais voulu patrimonialiser l'entreprise mais plutôt chercher à autonomiser les différents groupes qui le composent. C'est donc selon moi une condition indispensable du développement d'un organisation de ce type.
Pour en finir (encore et toujours) avec le jugement, le goût et les hiérarchies ?
Tout cela nous ramène évidemment aux jugements, au goût et aux hiérarchies imposés par la critique et les institutions où elle s'est infiltrée. À la suite de vos travaux et de ceux de vos collègues (Laurent Jullier en tête) ou d'un philosophe comme Laurent De Sutter, faut-il aujourd'hui en finir avec ce système de valeur ? L'une des forces de votre livre est de montrer comment celui-ci fonctionne sociologiquement dans un cadre précis : ce qui le rend plus fragile encore.
Mon travail consiste à identifier les points d'appui sur lesquels les gens font reposer leur(s) activité(s), ce qu'il en ressort et d’identifier des correspondances. Dans cette perspective, dans les sciences sociales, il me semble qu’il est nécessaire d’adopter une position prudente et modeste, alors que le ton prend des allures parfois prométhéennes avec la critique, telle qu’elle est pratiquée aux Cahiers du cinéma ou ailleurs. Selon moi, l’ambigüité vient d’une double critique. La première correspond à une entreprise de légitimation, à une une conquête du pouvoir ; la seconde est son envers : la critique philosophique comme projet d'émancipation, visant une libération de tous les déterminismes. Je ne sais pas si le programme de la critique comme émancipation est en soi tenable. Un critique qui se revendique d'une telle émancipation est en réalité pris au cœur d’un système de rapports de pouvoirs dont il est difficile de se démêler. Si l’on souhaite être totalement cohérent, ce qui est un des principes de jugement de la critique philosophique, ces deux activités, conquête du pouvoir et recherche de liberté, devraient être résolument distinguées. Bazin célébrait l'impureté du cinéma, mais de mon point de vue la pureté de la critique réside dans sa volonté de réintroduire une émancipation esthétique dans le domaine esthétique.
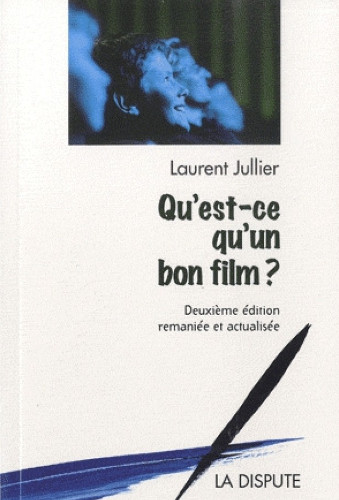
Dans Qu'est-ce qu'un bon film ?(6), Laurent Jullier avançait un argument intéressant : le critique appartenant à des revues intellectuelles au capital symbolique fort (les Cahiers, Inrocks,...) préférera toujours à une œuvre dite "finie", calculée et commerciale, le film fragile formellement inventif et ouvert, même si celui-ci peut être raté ou mineur. Jullier "milite" au contraire pour une égalité de traitement car tout dépend de l'expérimentation qu'on peut faire du film. On retrouve bien sûr ici les pratiques bien ancrées d'une politique des auteurs et l'héritage sociologique que vous décrivez dans votre livre. Que pensez-vous de cette « politique du goût » ?
Une œuvre "à trous" permet de s'y glisser et d'y glisser un peu de soi (c'est cela aussi, la critique), de se raconter, de s’inventer, de se rêver à travers les films, c’est-à-dire les autres. Cette esthétique fragile peut être mise en relation avec la condition toute aussi fragile du critique qui se trouve entre deux âges, entre deux mondes (celui de la littérature et du cinéma, de l'université et du journalisme, etc.), entre deux ambitions (celle de faire du cinéma sa vie et de l'écriture sa condition). Son temps est paradoxalement suspendu et attendu. Suspendu car le destin n’est pas joué. Attendu car beaucoup d'attentes entourent le critique. Au sein de la revue, ils ont pour beaucoup entre vingt et trente ans et jouent leur vie sans se l'avouer : ils font reposer énormément d'attentes sur leur écriture et leur passage au sein de la revue. C'est un régime d’attente adolescent, romantique, presque ridicule au sens français du terme, qui consiste à accorder énormément d'importance à des choses qui n'en ont pas forcément. Ça se voit à travers des petites choses comme la défense acharnée de films fragiles (esthétiquement forts mais économiquement faibles), qui peuvent être portés au sommet d’une revue pourtant patrimoniale, ou ce goût de la formule sentencieuse qui alimente bien des malentendus.
Le cas de Steven Spielberg est un exemple parmi d'autres de réhabilitation, une pratique qu'aime particulièrement la critique au capital symbolique fort et qui justifierait en partie son existence. Celle-ci se fonde à nouveau sur le goût et certains critères un peu flous. Comment comprenez-vous cette tendance ?
On peut évidemment lier ce phénomène de réhabilitation à la mécanique du critique, son agenda personnel, à savoir se distinguer de ses collègues, des autres rédacteurs de la revue où il écrit et l'histoire de celle-ci. Quand un critique s'inscrit dans cette logique de distinction et de patrimonialisation, il doit réaliser des "coups" en montrant comment un tel ou un tel auraient mal vu ou pas vu contrairement à lui.
Toujours dans le livre de Laurent Jullier, un critique des Inrocks et ancien des Cahiers du cinéma revendique clairement la supériorité de sa capacité à juger les films. Son œil savant et ses perceptions plus fines lui permettraient de sceller incontestablement la qualité d'un film. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la relativisation de la position du critique, rien ne semble pourtant affecter son capital symbolique. Le critique, du moins celui qui fait partie d'une revue symboliquement forte ayant pignon sur rue, semble conserver et entretenir son "aura" en jouant avec sa position dominante.
"Rien ne semble affecter le capital symbolique", je n'en suis pas sûr et je resterais prudent. Les gens qui le lisent peuvent très bien s'opposer à lui. Il faut d'abord voir ce qu'on entend par capital symbolique. Peut-être que ses positions sur les réseaux sociaux n'affectent pas ses autres formes de capital : social, économique, culturel, qu'il a acquises dans le milieu professionnel. L'impact sur le capital symbolique reste toujours difficile à mesurer. On peut certes estimer le nombre de références et de sorties mais cela n’épuise pas complètement le sujet. C'est pourquoi on l'appréhende comme la somme des trois autres.
La notion de beauté semble être la valeur principale avec laquelle le jugement de goût rend son verdict. Le critique appartenant à une revue au capital symbolique fort (qu'elle soit cinéphile ou non) se contente bien souvent de dire simplement que "c'est un très beau film" et, dans le cas inverse, que celui-ci est "d'une rare laideur". Comment comprenez-vous l'usage langagier qu'on fait aujourd'hui d'un concept aussi complexe que celui du Beau ?
Le concept de beauté était déjà celui qu'utilisait Kant. Je ne sais pas si le critique dit "simplement" qu'un film est beau. L'enjeu est plutôt de dire pourquoi il le trouve beau ou non, et si la revue a un point de vue. Cela renvoie à des questions d'explicitation de soi, de légitimation des œuvres qui se comprennent dans des querelles de goût.
Il semble également que le concept de morale perde petit à petit du terrain. On ne brandit plus systématiquement le travelling de Kapo. Néanmoins, on recourt encore à cette "loi morale" faute de mieux, surtout lorsqu'un film utilise le procédé de l'immersion. Ce film serait « immonde » ou « abject ». De manière générale, il semble y avoir une réelle confusion à ce niveau et un traitement inégalitaire entre les films et les cinéastes (Haneke, pour ne citer que lui au rang des « victimes »). Comment analysez-vous ce phénomène ?
Le concept de morale est peut-être moins visible mais ce qu’il désigne demeure et reste indissociable du jugement de goût. C'est une ambiguïté très importante à clarifier. Les critiques sont aussi des entrepreneurs de goût comme il y a des entrepreneurs de morale (selon le concept forgé par Howard Becker), disant ce qu’est le bien et le mal. Le critique énonce le sens moral des films et s'oppose à travers lui dans une économie des discours, des images et des textes.
Notes
