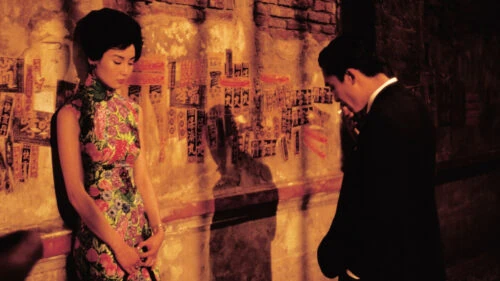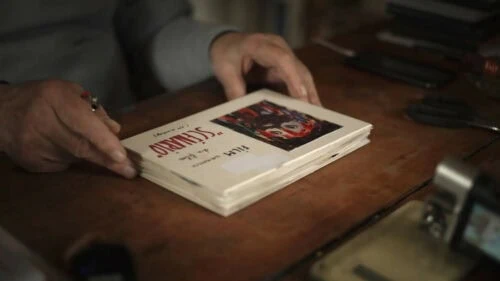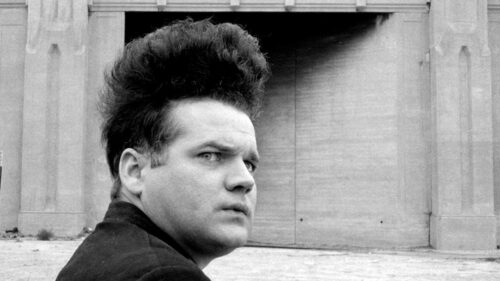Dans les sociétés où règne l'oralité, la parole fait lien et loi et son instrument est la voix. Y vivre sans voix dans le cantonnement de la parole qui manque, c'est être alors sans pouvoir en étant la proie des lions qui s'en disputent la part. Le cinéma est fait pour cela quand il montre que le monde se partage entre des parlants et des muets et si les premiers exercent un pouvoir sur les seconds, ces derniers ne sont pas seulement des êtres d'impuissance, mais les sujets d'une autre puissance en contestant au verbe sa domination. Quand l'œil se met à écouter, le regard se trouve dès lors disposé à voir l'inouï coincé au fond de la gorge tout en participant à faire des bouchons d'oreilles. L'inouï est un non (la voix qui manque n'a pas droit au chapitre), c'est un oui aussi (ce qui se tait est une pensée dont le silence résiste aux moyens de la verbaliser). Avec la fluidité de l'eau que le vent doucement remue, Den Muso – La Fille mêle ainsi les registres entre l'éloge et l'élégie, l'observation documentaire et le drame social, la critique politique et la tragédie antique, le cas particulier et son exemplarité générique, son universalité transculturelle et sa singularité quelconque. La plainte de Ténin, la sans-voix, est la complainte de la jeune femme violée par tous ceux qui auront parlé à sa place, et dont la puissance de mort est l'énigme incendiaire d'un désaveu collectif. Le silence que la parole outrage, dans ses droits qui oublient ses devoirs à son égard, déchaîne alors la rage, ses coups de sang asphyxiant les parlants et ses coups de soleil incendiaires. Le cinéma en répond en prenant son parti – celui de Souleymane Cissé, au nom du mystère de son enfance impartie.