
Michael Haneke : 71 Fragmentations d'un consensus critique avec Sarah Chiche
L'auteur de l'Éthique du Mikado se penche avec nous sur quelques singularités qui fragmentent le consensus critique qui entoure la réception de « Happy End ». Questions, notamment, de tendresse et de moyens de mourir ou de se laisser mourir, mais aussi de tuer ou de se laisser tuer.
Interview avec Sarah Chiche à propos de « Happy End », du cinéma de Haneke et de l'Éthique du Mikado
Longtemps, on avait pensé que la critique était fâchée avec Michael Haneke. Les films se succédant, les poncifs s’accumulaient, toujours plus gênants les uns que les autres : réalisateur frigide, « père fouettard autrichien », etc. À la véritable confrontation aux images, on semblait préférer les attaques personnelles envers le cinéaste, façon bien commode de faire l’impasse sur les vrais problèmes. Et puis, en 2015, a paru aux Presses Universitaires de France, un petit essai très singulier : avec Éthique du Mikado, l’écrivain et psychanalyste Sarah Chiche écoutait enfin ce que les films de Michael Haneke avaient à nous dire. Dans une écriture fragmentaire, qui tient autant des Minima Moralia d’Adorno que, justement, du cinéma originel de Haneke (sa fameuse « trilogie de la glaciation », mais aussi son adaptation du Château de Kafka, ou encore Code Inconnu), Sarah Chiche interrogeait plus particulièrement la substance éthique de ce cinéma – soit, tout simplement l’impensé jusque-là total de l’œuvre de Michael Haneke, qu’on avait très vite réduite à une série de coups de massue moralisateurs. À l’occasion de la sortie de Happy End, nous avons eu le grand plaisir de nous entretenir avec l’auteur d’Éthique du Mikado. Nous ne pouvions rêver meilleure interlocutrice car, avec ce douzième long-métrage, à la fois très cohérent eu égard au reste de sa filmographie, et par instants d’une étrangeté déstabilisante, le réalisateur autrichien met résolument la pulsion de mort au cœur de ses images. Nous remercions chaleureusement Sarah Chiche de nous avoir aidé à entrer, à notre tour, dans cette incroyable danse macabre.
1. Du viewer's digest critique à la singularité affective
Maël Mubalegh : Comment avez-vous trouvé Happy End eu égard au reste de la filmographie de Michael Haneke ? Avez-vous été surprise par le film ?
Sarah Chiche : On a pu lire ici ou là que Happy end était une sorte de menu best of de la filmographie de Michael Haneke. À mon sens, si l'on pose le postulat que, dans l'œuvre de Haneke, chacun de ses films pour le cinéma, de ses films pour la télévision et de ses mises en scène d'opéra compose un fragment dont Happy end serait plus encore que le résultat, le simple digest, alors on risque de passer à côté de ce film dans ce qui fait toute son originalité et, disons-le, sa nouveauté.
Bien sûr, un familier de l'œuvre de Haneke retrouvera, avec bonheur ou lassitude, c'est selon, les mêmes couleurs musicales, les mêmes motifs à l’œuvre que dans ses précédents films, notamment :
- Une peinture de la déliquescence de la bourgeoisie occidentale cramponnée, vaille que vaille, à ses tristes privilèges. Elle est ici campée par de bien tristes bourgeois de Calais aveugles, sourds, égoïstes qui, même lors de leurs repas de famille, n'ont plus rien d'autre à partager qu'un silence glacé comme un tombeau. Ils sont, à mon sens, des Damnés du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'ils expérimentent la damnation sous un ciel vide de Dieu où l'enfer revêt l'apparence de la vie en famille.
- Corrélativement, l'idée que nous sommes tous des héritiers et que les problèmes sexuels de nos parents (séparation d'Anne Laurent d'avec le père de Pierre, dont on ignore qui il est, séparation des parents d’Ève avant le début de l'histoire, infidélité du père d’Ève…) vont devenir les problèmes existentiels des enfants : Ève (Fantine Harduin) est une enfant criminelle, Pierre (Franz Rogowski) est incapable de prendre la tête de l'entreprise familiale dirigée de main de maître par Anne, sa mère (Isabelle Huppert) et ne trouve d'issue que dans l'alcool, la fréquentation des salles de karaoké ou la bagarre.
- Une faute morale perpétrée hors film, avant que l'histoire ne commence. Ici, la façon ignominieuse avec laquelle la France traite ses réfugiés, le divorce des parents d’Ève et ses tristes conséquences sur la mère de la petite fille, le meurtre de la femme de Georges, la condescendance et le mépris de classe avec lequel les Laurent traitent aussi bien le monde du dehors, incarné par les réfugiés, que leurs employés de maison, etc.
- Le crime comme possible acte d'amour monstrueux : tuer sa mère inconsolable et dépressive comme le fait Ève ou sa femme en fin de vie, comme le fit Georges, acte d'amour suprême ou crime odieux ?
- L'intrication entre l'argent, la haute culture et la plus grande perversité : reclus dans leur hôtel particulier, les membres de la famille Laurent ne rêvent, pour soulager leur désespérance, que de meurtre, d'euthanasie, ou de sadomasochisme. Claire Vanel (Hille Perl) la femme qui joue de la viole de gambe à la perfection trouve un soulagement dans le fait d'être traitée par son amant comme un objet ; Thomas Laurent (Mathieu Kassovitz), qui est médecin, c'est-à-dire dont on suppose qu'il a fait des années d'études à l'université pour apprendre à soigner son prochain et sauver des vies est en même temps un fils incapable de sauver son père de ses tentations suicidaires, un père incapable d'amour, un époux incapable de rester fidèle.
- L'incontournable meurtre d'animaux qui, dans la filmographie de Haneke, obéit toujours à une logique darwinienne : survivre dans cette jungle qu'est la vie en société suppose d'en passer par le meurtre de plus faible que soi, seuls les plus forts tirent leur épingle du jeu. Les hommes humilient les femmes qui humilient les enfants qui humilient les animaux. Le hamster de la petite Ève a le bon goût de tirer sa révérence dès la première scène du film. Puis c'est la mère. Puis c'est le grand-père qui tente de se supprimer. Puis c'est l'enfant qui fait une tentative de suicide ; plus tard, Georges parlera à sa petite fille d'une scène qui l'a profondément marquée, où un grand oiseau en déchiquette un petit, et la beauté térébrante avec laquelle Jean-Louis Trintignant prononce, d'une voix sépulcrale, « déchiqueté », transforme, je trouve, ce mot en image. En l'entendant parler, sans même avoir assisté à la scène décrite par le personnage, le spectateur la voit distinctement, la mise en pièces du mot dans la bouche de Trintignant devenant la mise en pièces de l'animal supplicié par plus fort que lui.
- L'inversion d'un certain nombre de valeurs qui ont été au fondement du vivre-ensemble dans les sociétés occidentales : il n'y a nul mérite à faire le bien puisqu'il n'y a pas de salut possible ni dans ce monde-ci, ni dans le monde d'après ; les étrangers sont tout juste bons à être des domestiques ou des intrus dont il faut se méfier ; la vie de famille n'apporte ni réconfort ni joie ; le couple est une vaste mascarade ; grandir n'est jamais le lieu de l'expression de l'épanouissement personnel et de la liberté, puisque, in fine, laisse entendre ce film, notre liberté ne peut s'exercer que dans le fait de s'extraire du champ social en choisissant sa mort par le suicide (ce que tentent de faire Ève et Georges), ou en la choisissant carrément pour l'autre (ce que fait Georges pour sa femme, comme dans Amour, ou ce que fait Ève pour sa mère, et ce qu'elle se propose de faire pour son grand-père). Cette question était évidemment déjà au travail dans Amour, dans La Pianiste, dans Benny's Video ou dans Le Septième continent, pour ne citer que ces films-là. Mais il me semble que cette inversion des valeurs, que je qualifierais de sadienne (et non pas sadique) est radicalisée jusqu'à l'épure dans Happy end et annoncée dès l'affiche du film. Qu'y voit-on ? Un titre « Happy end » emprunté aux contes de fées (le fameux topos du « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ») et aux comédies romantiques (dont on attend qu'elles aient une fin heureuse), flottant au-dessus d'une étendue bleu horizon découpée en deux parties. En haut un ciel vide de Dieu. En bas, une mer dans laquelle bien des bateaux remplis de réfugiés font naufrage... On se demande dans lequel des deux il faudrait se noyer pour pouvoir enfin avoir sa propre fin heureuse, c'est-à-dire trouver son soulagement dans l'extinction de soi, ou l'extinction de l'espèce. Mais ces naufrages-là, nous ne les verrons pas dans le film. Pas plus que nous ne verrons ni la jungle de Calais, ni le corps de l'ouvrier après l'accident de chantier au début du film, ni les meurtres, ni les tentatives de suicide, ni les actes sexuels crus dont il est question sur internet, ni le chien qui mord l'enfant des gardiens. Et c'est peut-être une nouveauté dans le cinéma de Haneke. Rien de particulièrement spectaculaire ne nous est montré, hormis le spectacle de notre médiocrité ordinaire. Nous sommes malades. Malades de notre manque d’amour. Malades de notre manque de générosité. Malades de notre manque de compassion(1). C'est en cela que je trouve ce film terriblement actuel : ça n'est pas une dystopie ni une fiction postapocalyptique. Pour autant, l'idée d'une fin possible de l'humanité, ou, tout du moins, l'idée que, possiblement, nous sommes tous déjà morts, y est sans cesse présente, de façon très subtile, et donc, d'autant plus angoissante.

Beaucoup s'attendaient, semble-t-il, à voir un film sur les migrants et la jungle de Calais. Il y a, notamment en France, toute une tradition du film à message et du film social, et Haneke ne s'inscrit résolument pas dans cette tradition-là. C'est un cinéma qu'il respecte mais qui ne l'intéresse pas. Les réfugiés n'apparaissent que comme des ombres, au bord de l’écran ou au détour d’une phrase : dans les discours des bourgeois de Calais lors de la fête d’anniversaire (« il y en a de plus en plus »), quand Georges, cloué sur son fauteuil roulant, les aborde pour monnayer sa montre contre, peut-être, une arme, dans les cinq dernières minutes du film. Quand ils apparaissent enfin, dans la scène de la fête de mariage – et qu'est-ce qu'un mariage sinon l'institution sociale et bourgeoise par excellence - c'est parce que le fils de famille les instrumentalise pour, littéralement, emmerder sa famille. La première fois que j’ai vu cette séquence, je dois vous avouer que je ne l’ai pas aimée. Comment peut-on faire surgir des personnages de réfugiés de façon si grinçante comme dans le théâtre de marionnettes ? Puis j’ai repensé à la note d'intention du film qui dit : « Tout autour de nous le monde, et nous, au milieu, aveugles. » Nous savons qu'il y a chaque jour, des enfants, des femmes et des hommes qui se noient au large des côtes méditerranéennes ou entre Calais et l'Angleterre, parce qu'ils fuient leur pays en guerre et que, en France, nous sommes incapables de leur offrir un accueil digne de ce nom. Nous le savons, tout comme nous savons qu'en France, on gaze les réfugiés de Calais ou du boulevard de la Chapelle dans le XVIIIe à Paris, au gaz poivre pour les faire déguerpir, mais nous choisissons de fermer les yeux. Pourquoi ? Parce que, tout comme les personnages de ce film, même quand nous n’avons pas leur fortune, nous sommes de pauvres marionnettes agies par nos passions tristes et nous sommes bien plus préoccupés par la conservation de nos petits privilèges, par les jouissances et les chagrins que nous procurent nos histoires d'amour et notre vie sexuelle, et par la mise en scène de notre immense petit moi via les réseaux sociaux et les applications internet. L’argent et l’héritage sont évidemment envisagés dans ce film comme une malédiction. Ce qui se transmet, notamment aussi à cause de l’argent, c’est la froideur, l’indifférence, le défaut d’humanité. Mais pas besoin d’être un bourgeois pour être égoïste et centré sur soi. La médiocrité est, je vous rassure, une valeur universellement partagée.
Il y a une nouveauté essentielle dans Happy end, et je rejoins l'analyse de Philippe Rouyer sur ce point, c'est que c'est en effet, paradoxalement, et pour quelques scènes, l'un des films les plus tendres de Haneke. On peut notamment citer la scène dans laquelle la petite Ève filme son demi-frère dans son berceau. Envisager qu’Ève regarde uniquement ce bébé s'agiter comme elle regardait Pips son hamster s'agiter dans sa cage juste avant de le tuer, c'est passer à côté de l'ambivalence qui est à l’œuvre chez les enfants de familles décomposées puis recomposées qui, un jour, doivent faire de la place dans leur vie et dans leur cœur pour un nouvel enfant. Et Fantine Harduin, avec son visage d'une gravité déconcertante pour une enfant, sait restituer cette ambivalence-là avec une justesse qui fait d'elle une jeune actrice très prometteuse. On trouve également dans ce film, une scène que je considère comme la plus belle du film. Une tendresse particulière y est à l’œuvre. Elle lie deux êtres qui, par-delà leur différence d'âge, se sont reconnus. Ils sont bien de la même famille de sang, mais, plus encore, de la même famille de cœur.
Le grand-père avoue à sa petite-fille que, naguère, par amour, il a tué sa femme en fin de vie. En retour, Ève lui confie avoir déjà empoisonné une camarade de classe en colonie de vacances – cet aveu en cachant évidemment un autre, le meurtre de la mère. Une mère déprimée, qui, depuis la perte de l’enfant qu’elle a eu, avant que l’histoire ne commence, et qui est mort d’une pneumonie, ne voulait plus vivre. Il est des moments où notre existence devient si vide de sens que l’on se demande bien pourquoi il faudrait jouer les prolongations. Qu’Ève tue sa mère relève-t-il du geste criminel ou de l’acte d’amour insensé ? À chacun d’entre nous d’examiner, silencieusement, en soi, la réponse.
2. Critique(s) du logos bourgeois
Par son titre qui semble annoncer, sur un mode ironique, un programme sadique, on pourrait être tenté de rapprocher Happy End de Funny Games. Mais ce qui est amusant, si je puis dire, c’est que là où le film de 1997 était - à mon sens - plombé par son cynisme univoque, le présent opus fait montre d’un détachement, d’une forme de liberté par rapport à son objet, qui y rend la critique de la bourgeoisie beaucoup plus intéressante. Je m’explique. Dans votre essai, au paragraphe 52 (intitulé « Au hasard Georges et Anne »), vous commentez le générique d’introduction de Funny Games en soulignant que, dès le début, Georges et Anne, le couple qui sera plus tard martyrisé dans le film, exercent une forme de violence vis-à-vis de leur fils, en ce qu’ils lui imposent un jeu très snob - lequel consiste à reconnaître l’interprète de tel ou tel morceau de musique classique. En soi, cette idée de mise en scène est loin d’être mauvaise. Mais en même temps, on entend par intermittence, en superposition extradiégétique, des extraits de hard rock dont le volume est poussé à fond - bande son qu’on entendra ensuite à deux reprises, et notamment sur le tout dernier plan du film. Je trouve ce procédé à l’image de Funny Games : chaque idée de mise en scène potentiellement bonne est accompagnée d’une signature superfétatoire, qui vient nous faire comprendre que nos réflexes de spectateurs - éprouver de l’empathie pour ce couple de bourgeois sans histoire - sont idiots, puisqu’ils trahissent eux-mêmes le petit-bourgeois en nous : dans la séquence de générique, quand le hard rock se fait entendre, tout ce qu’on a envie de faire, c’est de se boucher les oreilles. Haneke semble nous prendre la main dans le sac et nous pointer du doigt d’un air accusateur : « Vous vous croyez malins, quand tout ce que vous désirez, c’est de partager le bonheur médiocre et fallacieux de cette famille bourgeoise ? ». « Happy End », quant à lui, est certes aussi un titre « programmatique », mais je trouve que la violence petite-bourgeoise qui y est montrée ressort d’autant mieux qu’elle n’est jamais filmée de façon spectaculaire : je pense notamment à cette scène où le personnage d’Isabelle Huppert, Anne, euphémise par tous les moyens l’accident survenu sur le chantier de construction. Ici, Haneke ne juge pas, il ne piège personne : il montre un logos bourgeois à l’œuvre, en perpétuel mouvement, sans cesse à la recherche de sa propre justification.
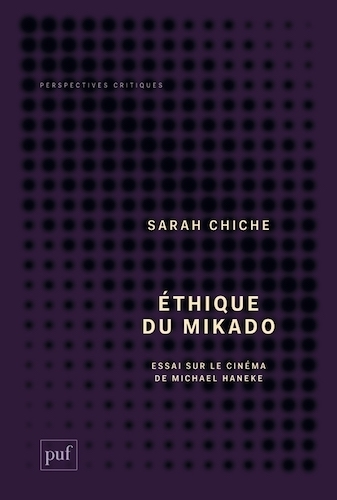
Vous avez raison de dire que la vie est en soi un programme sadique. Dès l'enfance, on connaît la fin du film : un jour nous allons mourir. Et notre vie durant, nous allons passer notre temps à nous agiter et à faire toutes sortes de choses, du bien comme du mal, pour tenter de faire taire en nous l'angoisse que nous n'avons pas choisi de figurer au générique de ce grand film entre drame et farce qu'est l'existence. J'ai en effet souligné dans Éthique du Mikado que, à mon sens, dans Funny Games, la famille torturée dans sa propre résidence secondaire par ces deux anges exterminateurs que sont Pierre et Paul n'est pas uniquement victime d'un mal absolu qui arrive du dehors. Dans la toute première scène du film, que vous mentionnez, on voit que cette famille exerce elle aussi une violence d'autant plus insoutenable qu'elle emprunte le masque de la culture et de la douceur policée. Georg et Anna Schober, les parents de Funny Games, ont été dressés à pouvoir faire la différence entre du Haendel et un air chanté par Gigli. Et ils attendent, en toute logique, avec l'arrogance calme propre à leur classe sociale, qu'il en soit de même pour leur petit garçon. Il y a, en effet, bien des moments dans Funny Games (le film de 1997 comme son remake de 2007) où le spectateur est pris la main dans le sac, parfois, convenons-en, de façon un peu professorale et dogmatique. Happy end laisse le spectateur autrement plus libre, parce que ce film ne nous prend pas du tout la main dans le sac. Il se contente, de façon strictement dépsychologisée, de nous montrer nos grandeurs, nos médiocrités, et notre aveuglement. Et c'est la raison pour laquelle c'est, à mon sens, un film autrement plus dense, autrement plus riche, autrement plus angoissant et vertigineux que ne l'est Funny Games.
La question de la fin heureuse est, en elle-même, très intéressante. Savez-vous que dans les années 1990, un think tank proche du parti républicain américain avait fait du lobbying auprès d'Hollywood pour que les films continuent à valoriser l'image du mariage comme fin heureuse ? Tout ceci est subverti d'une façon très farcesque à la fin du film. On pourrait laisser penser que, comme dans les comédies romantiques ou comme dans les opéras à la Cosi Fan Tutte (rappelons que c'est, avec Don Giovanni, un des deux opéras mis en scène par Haneke), tout est bien qui finit bien. Et tout finit bien grâce au mariage. Mais, sans dévoiler tout ce qui se passe dans cette joyeuse petite fête de famille (et il faut regarder la scène plusieurs fois pour en percevoir toutes les subtilités), la fin heureuse n'est vraisemblablement pas celle-là. Deux personnages vont, à un moment donné, s'extraire de la fête, et donc du champ social, pour laisser libre cours à leurs pulsions. Il y a quelque chose de très juste dans la façon qu'ont le grand-père et la petite fille de s'avancer résolument, loin des autres, et librement, vers ce qui leur est le plus familier : la mort comme fin heureuse. On est tous en route vers quelque chose – et ultimement vers la mort. Mais nous l’oublions pour pouvoir continuer à vivre. Pas ces deux personnages. Eux savent, depuis le début du film, que c’est vers cette fin-là qu’ils cheminent. Et cette scène finale, qu'on aime ou non le cinéma de Haneke, justifie à elle seule la grandeur de Happy end. Elle me fait penser à deux textes précis. D’abord à la fin de L’homme qui aimait les îles, une des dernières nouvelles qu’a écrites DH Lawrence. Haneke l’a confié dans certains entretiens, notamment dans une revue anglo-saxonne : Lawrence est l’un de ses auteurs préférés et ça n’est pas, soit dit en passant, un auteur réputé pour sa froideur et son manque d’amour de la vie. L’homme qui aimait les îles raconte l’histoire d’un homme qui s’isole de plus en plus, jusqu’à, au soir de sa vie, se fondre dans la mer, et y mourir. Mais j’associe aussi cette scène à Beckett, et plus particulièrement à un passage que l’on peut trouver au début de Cap au pire. On peut s’amuser à revoir la dernière séquence du film avec ces mots-là en tête : « Main dans la main ils vont tant mal que mal d’un pas égal. Dans les mains libres – non. Vides les mains libres. Tous deux dos courbés vus de dos ils vont tant mal que mal d’un pas égal. Levée la main de l’enfant pour atteindre la main qui étreint. Étreindre la vieille main qui étreint. Étreindre et être étreinte. Tant mal que mal s’en vont et jamais ne s’éloignent. Lentement sans pause tant mal que mal s’en vont et jamais ne s’éloignent […] Tant mal que mal s’en vont comme un seul. Une seule ombre. Une autre ombre. »(2)
3. Todesarten
À propos de « happy end » : vous avez, semble-t-il, eu une intuition géniale dans votre essai, puisque vous avez intitulé l’un des paragraphes « Fin heureuse » ! Blague à part, ce que, dans ce paragraphe, vous écrivez sur la mise en scène de la mort dans le cinéma de Haneke, est très intéressant. Vous insistez en effet sur son pragmatisme : sans s’attarder dessus, sans la rendre particulièrement sordide, il montre la putréfaction dans le quotidien de ses personnages. On pense bien sûr à l’ouverture d’Amour, avec la découverte du cadavre enfermé dans la chambre conjugale, et la pestilence qui a gagné l’appartement. C’est quelque chose que je trouve très beau dans les films de Michael Haneke : la mort est bien entendu redoutée, mais dans un même mouvement, le gouffre de possibles qu’elle représente est susceptible d’aspirer à tout moment les personnages. Cela évoque de façon troublante les « Todesarten » d’Ingeborg Bachmann, auxquelles vous faites référence dans un autre paragraphe d’Éthique du Mikado - ces « différentes façons de mourir », qui reviennent, pour la narratrice de Malina, à travailler à penser ce qui, pour chacun, est précisément impensable : sa propre mort. On le voit très bien, par exemple, à la fin de La Pianiste : Erika (Isabelle Huppert) sort son couteau de cuisine, le plante dans sa poitrine… et ne meurt pas. Les derniers mots du roman d’Elfriede Jelinek suggèrent l’étonnement par leur trivialité : « Sie geht nach Hause. Sie geht und beschleunigt langsam ihren Schritt. » (« Elle rentre à la maison. Elle part et, peu à peu, accélère son pas. »). Si, comme Jelinek, Haneke fait tout pour donner à la scène l’apparence de la banalité la plus totale, on est pourtant surpris par l’absence de l’événement; cette banalité nous frappe : même préméditée, la mort échappe à toutes les spéculations. C’est exactement cette scène du suicide manqué de la pianiste que j’ai vue en surimpression dans les derniers plans de Happy End, lorsque Ève (Fantine Harduin) sort son iPhone pour filmer le - possible - suicide de son grand-père : dans les deux cas, Haneke arrive à saisir dans le visage de ses actrices une forme de vertige existentiel, comme si, au milieu du quotidien le plus prosaïque, elles venaient d’arriver au bord de l’abîme.

L'intuition, dit Dostoïevski, « c'est la venue du cœur dans les ténèbres » et je vous remercie d'être un lecteur aussi rusé. Dans les films de Haneke, les personnages marchent toujours au bord d'un gouffre, ignorants des motivations réelles qui les animent. Tout comme ils semblent ignorants de ce qui, à un moment donné, va les faire passer à l'acte et les pousser au meurtre ou au suicide. Dans Caché, un couple de bourgeois parisiens reçoit, de façon répétée, et anonyme, des cassettes vidéos et d'horribles dessins. À un moment donné, Majid (Maurice Bénichou), un algérien, vient se trancher la gorge sous les yeux de Georges (Daniel Auteuil). A-t-il prémédité son suicide de longue date ou non ? Quand, dans Benny's video, le jeune Benny aperçoit une jeune fille qu'il invite à monter chez lui, puisque ses parents n'y sont pas, a-t-il déjà l'intention de la tuer avec un marteau d'abattage dont il sait qu'à la ferme son père et d'autres hommes se servent pour tuer les cochons ? Ou bien, cela lui vient-il subitement quand il pointe l'arme sur la jeune fille et qu'elle le traite de lâche qui n'ose pas tirer ? Laissons la réponse à l'appréciation de chacun.
Tout comme l'était Thomas Mann, Haneke est obsédé par le fait que seul l'art permet peut-être d'entrevoir le vrai visage des choses. Qu'il s'agisse d'une actrice exceptionnelle comme Isabelle Huppert (à mon sens la plus grande actrice contemporaine) ou d'une jeune actrice comme Fantine Harduin, Haneke sait conduire ses actrices, jusqu'à ce point où elles atteignent la note juste et jouent à la perfection, justement parce qu'elles ne jouent plus. Je ne suis pas sûre cependant que dans les films de Haneke, la mort soit si redoutée par la plupart de ses personnages – car on ne redoute que ce qui est étranger. Or, elle semble plus que familière pour bien de ses personnages, dont on pourrait dire que certains parlent déjà depuis le point de vue de la mort. C'est évidemment le cas de Georges et Eve dans « Happy end ». La phrase que la petite Eve répète souvent est « Je sais pas ». Elle ne sait pas pourquoi elle a tué, pourquoi elle veut tuer encore. Si elle le savait, elle ne tuerait probablement pas et n'aurait pas non plus essayé de se suicider. Mais elle est, malgré elle, aspirée par la fixité d'un scénario innommable : filmer un meurtre déguisé en suicide. C'est ce qu'elle fait avec sa mère au début du film. Et c'est ce qu'elle tente de faire avec son grand-père à la fin du film. Le gros plan sur le visage de Fantine Harduin est en effet glaçant car, au fur et à mesure que nous voyons l'abîme se refléter dans ses yeux, nous le voyons s'ouvrir en nous – et nous nous souvenons alors que chacun d'entre nous porte la mort en soi.
4. Les enfants du diable
Dans 71 Fragments d’une chronologie du hasard (1994), un adolescent est amené, par une ruse perverse de la fatalité, à tuer plusieurs inconnus. Dans Benny’s Video (1992), Benny tire certes sur la jeune fille qu’il vient de rencontrer au vidéoclub, mais la mise en scène laisse entendre qu’il s’agissait peut-être d’un faux mouvement. Plus proche de nous, Le Ruban Blanc (2009) suggère que, par leurs méfaits, les enfants du village actualisent les potentialités morbides de leur éducation rigide. Au début de Happy End, la jeune Ève commet un matricide, mais on ne saura jamais si elle en a réellement eu l’intention - peut-être cela n’était-il qu’un jeu. D’un point de vue plus psychanalytique, que pensez-vous de cette figure récurrente dans le cinéma de Michael Haneke : l’enfant « psychopathe », l’enfant - presque malgré lui - criminel ? Et, plus généralement, de cette représentation de l’enfance, dépourvue d’angélisme, qui parcourt la filmographie de Michael Haneke ?
Vous êtes bien optimiste quant aux intentions du jeune Benny ! Mais c'est intéressant que vous puissiez voir dans son geste un faux mouvement et conclure qu'il n'a pas fait exprès là où pour d'autres spectateurs, c'est évident, Benny a abattu cette jeune fille froidement. C'est ça qui est, à mon sens, assez génial avec les films de Haneke : chaque spectateur participe activement au film, en y apportant son propre regard, ce qui en fait un cinéma profondément moral – mais certainement pas moralisateur. Pour en revenir à votre question, on trouve, au début du XXe siècle, aussi bien en Allemagne, en France, qu'en Belgique, toute une littérature psychiatrique qui traite de « l'enfant du diable ». À l'époque, on croyait encore fortement à l'idée du criminel-né ou du « pervers constitutionnel ». On pensait que les enfants psychopathes étaient intrinsèquement corrompus – et non pas qu'ils l'étaient parce qu'ils avaient eux-même subi des horreurs ou traversé des drames. Ce qu'on appelait alors « enfant du diable », ce sont tous les petits criminels (comme dans Benny's Video, Le Ruban Blanc, Happy end, 71 Fragments d'une chronologie du hasard), les incendiaires (comme dans Le Ruban blanc), les petits voleurs (comme dans Caché), les bandes d'enfants malfaisants (Le Ruban Blanc, encore) pour lesquels ont été en partie créés des services de psychiatrie infantile. Pour Le Ruban Blanc, Haneke a raconté avoir lu beaucoup de traités puritains et d'ouvrages d'éducation des XVIIIe et XIXe siècle. On trouve, dans ces ouvrages, que l'historienne K. Rutschky puis la psychanalyste A. Miller, ont appelé « pédagogie noire », l'idée qu'éduquer un enfant revient à briser, pour son bien, ses instincts et sa volonté. C'est peut-être la raison pour laquelle nous arrivons, malgré tout, à pardonner aux enfants psychopathes qui traversent les films de Haneke. Parce que ce sont des enfants qui se rebellent contre la froideur et les compromissions fétides qu'oblige la vie en société. Ils haïssent entièrement, sans tricher. Et on ne hait entièrement que parce qu'on aime entièrement – sans tricher. C'est une chose que seuls les enfants savent faire. C'est peut-être la raison pour laquelle Georges choisit de demander non pas à sa fille mais bien à sa petite-fille, qui est encore une enfant, de l'aider à mourir.(3)(4)
Propos recueillis par Maël Mubalegh en septembre 2017.
Poursuivre l'analyse du cinéma de Haneke
- Nausicaa Dewez, « Happy End de Haneke : Bourgeois et Outsiders, Langues étrangères et Accents distinctifs », Le Rayon Vert, 10 octobre 2017.
- Jérémy Quicke, « L'enfermement chez Michael Haneke », Le Rayon Vert, 10 octobre 2017.
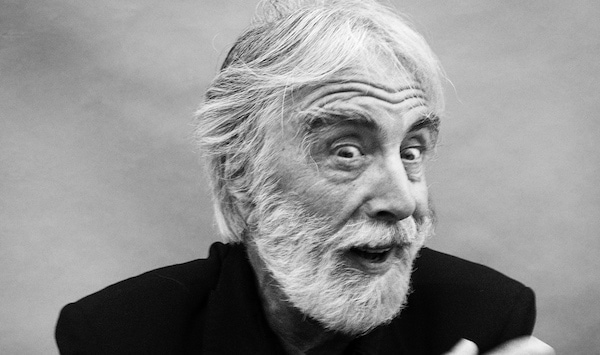
Notes
