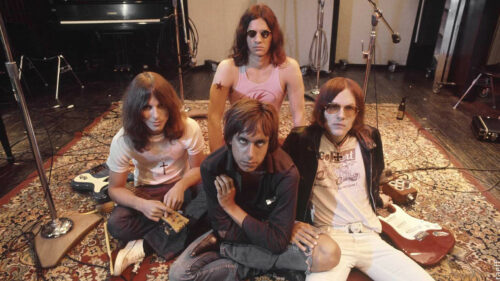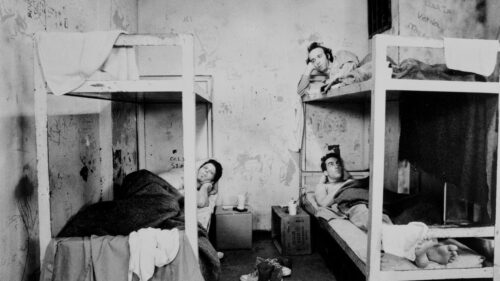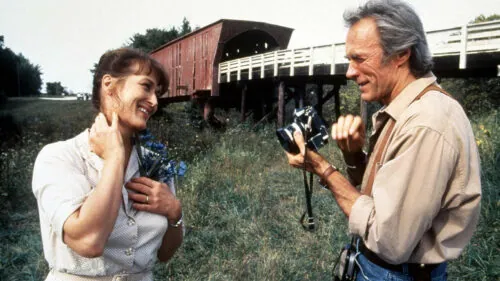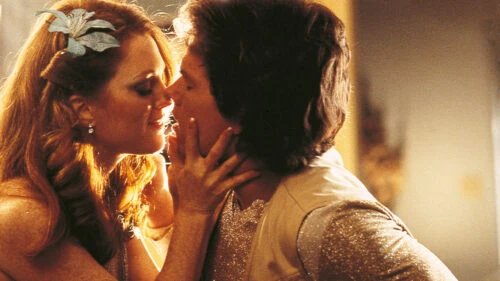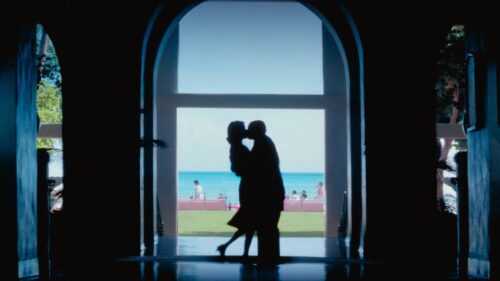L’île est le lieu de tous les fantasmes, celui d’un possible recommencement. Sam Raimi, dans Send Help, voulait en faire le lieu de la refondation de l’humanité en inversant les rapports de force homme-femme, après un crash d’avion. Mais ce que fait Sam Raimi, c’est plutôt recycler ce mythe en le croisant avec l’imaginaire contemporain de la télé-réalité du type koh-lantien. L’île n’est plus qu’un plateau interchangeable où se met en scène la compétition, la survie, l’élimination. Un lieu qui colonise au lieu de créer. Un lieu où le fantasme occidental de la liberté tourne court et l’accélérateur insulaire n’embrase rien d’autre que le vide.