
« Masques blancs, peau noire. Les visages de Watchmen » : Interview de Saad Chakali
Au départ de cinq motifs qui forment autant de questionnements où il redéplie sa pensée, Saad Chakali introduit son livre « Masques blancs, peau noire. Les visages de Watchmen » publié aux éditions L'Harmattan et consacré à la série de Damon Lindelof.
Choisir parmi les cinq motifs
I. Casser des œufs pour faire des gaufres ou pour faire des omelettes ?
II. L’effet de parallaxe est le fait des désaxés
III. Aime-moi et soulève ton masque, les blessures ont besoin de respirer
IV. L’amour, un don divin pour ne pas être un dieu
V. La meilleure série de 2019 est la meilleure série de 2020 (et la meilleure série de 2021 ?)
I. Casser des œufs
pour faire des gaufres ou pour faire des omelettes ?
On peut casser un œuf afin de faire plaisir aux enfants en leur préparant un dessert savoureux. C’est par exemple le bânh bia dont Angela Abar explique la recette à des élèves. Ainsi elle se souvient de son enfance vietnamienne tout en se faisant passer pour ce qu’elle n’est pas (la boulangerie est la couverture de la policière connue sous le pseudonyme de Sister Night). Ce sont aussi les gaufres cuisinées par son compagnon Cal Abar qui a oublié que son corps abrite un dieu. Et le père qui fait plaisir à ses trois enfants adoptifs ne sait probablement pas que le placenta signifie à l’origine un gâteau plat comme une crêpe ou une galette (plakous en grec, plakounia à l’accusatif). Ou un pancake comme Dougie Jones en raffole dans la troisième saison de Twin Peaks (2017), autre amnésique.
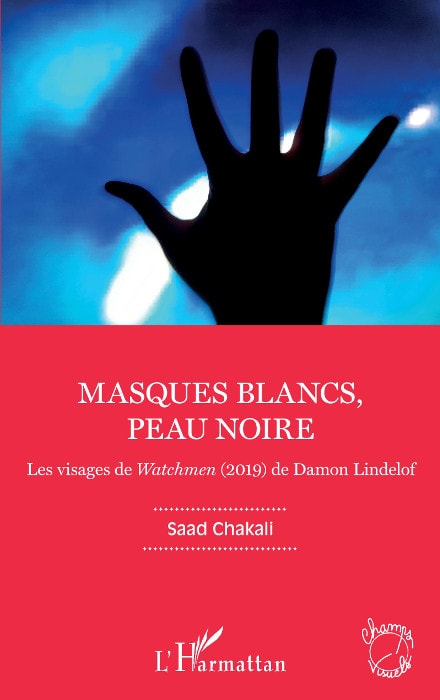
Tantôt l’œuf est une enveloppe opaque que l’on brise pour révéler, avec la distinction du blanc et du jaune, l’ambivalence des différences (quand elles tirent sur l’identité raciale en nourrissant la paranoïa obsidionale de ses gardiens) et des mélanges (quand ils se fondent dans un confusionnisme dangereux comme celui de la loi formelle virant à la morale jésuitique de la fin justifiant les moyens). Tantôt l’œuf est une écorce neutre qui recouvre le noyau d’une vérité cachée, celle d’une structure originaire dyadique (toute naissance est gémellaire en faisant du nouveau-né le double mutilé du compagnon des profondeurs qui y est resté, et à l’absence duquel il lui faut survivre).
On ne cesse pas de le remarquer dans les séries pilotées par Damon Lindelof : une chaussure vide fait toujours un couple boiteux avec un pied dénudé. Et le tout dernier d’indiquer qu’une femme a peut-être hérité des super-pouvoirs de son aimé. Au spectateur d’en décider, effet de parallaxe ou indécidabilité. Dans Lost (2004-2010), dans The Leftovers (2014-2017), dans Watchmen (2019), comme on boite, comme on claudique. Après tout ce sont les imbéciles qui croient ne pas boiter puisque l’imbécillité qualifie ceux qui pensent ne pas avoir besoin d’un bâton (baculum) pour avancer. Œdipe a été cet imbécile avant de se rendre à la raison de son prénom qui signifie « pieds enflés ». La boiterie est une boîte à malice indiquant notamment que, comme un homme à la mémoire barrée abrite en lui un dieu endormi, l’individu moderne est le contenant d’un contenu oublié, l’emmaillotage étouffant d’une dyade ignorée, l’abri bunkerisé d’un vide dont le remplissage peut être celui d’une volonté de néant, une poche à ressentiment. En ce cas, l’individualisme moderne est une coquille d’œuf à la noix et si le néant épuise tout, sa volonté est inépuisable comme en témoigne l’époque.
Peter Sloterdijk l’a montré dans Bulles (1998) : l’individualisme est l’écorce opaque d’un noyau de nihilisme placentaire.
Le nihilisme placentaire rompt le cordon de la cordialité interfaciale en faisant du visage de l’autre le miroir du même. N’est-ce pas Looking Glass ? Le nihilisme placentaire est au fondement de l’oubli de nos métamorphoses (exister consiste à répéter la rupture fondatrice de la naissance, c’est renaître pour un nouveau nouveau-né affrontant à chaque passage critique comme la rupture originaire des membranes). Comme de nos généalogies (l’arbre de la connaissance et de la vie a des ramifications racinaires qui plongent dans la nuit placentaire et des extensions branchues auxquelles pendent tantôt des pommes d’or comme la nuit étoilée de Van Gogh, tantôt des fruits étranges qui peuvent s’apparenter à des tomates pourries). Le dessert peut ressembler à une omelette norvégienne, froide à l’intérieur (la base de Karnak projetée des sables d’Égypte dans les neiges de l’Antarctique ou Europe en satellite de Jupiter) et chaude à l’extérieur (l’embrasement raciste de Tulsa en 1921 ou une pluie d’agent orange sur le Vietnam en 1971). Son goût n’en est pas moins douteux en ouvrant au désert – au « désêtre » comme en parle Alain Badiou.
« On ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs » a dit un responsable soviétique à Panaït Istrati pour justifier l’époque des grandes purges staliniennes. Ce à quoi l’écrivain communiste turc a répondu : « Très bien, je vois les œufs cassés, mais où est l’omelette dont vous parlez ? ».
Qui protège les gardiens et qui nous protège d’eux ? De quelles omelettes nos vies sont-elles faites ? Des omelettes baveuses mais pour quelles bavures ? Les Gilets Jaunes le comprennent à chaque fois que Jupiter leur arrache un œil.
Si l’on casse beaucoup d’œufs dans Watchmen, c’est qu’il s’agit pour Damon Lindelof de tirer du génial roman graphique du scénariste Alan Moore, du dessinateur Dave Gibbons et du coloriste John Higgins, publié en douze épisodes entre septembre 1986 et octobre 1987 comme les douze aiguilles d’une montre (Watch), de quoi cuisiner ses propres omelettes. L’œuf est un motif qui s’inscrit dans une série déjà là, comme une virtualité qui n’attendait rien sinon que quelqu’un vienne pour l’actualiser en en prolongeant les filaments. Horloges et cadrans, pleine lune et cratère martien, globe oculaire de requins ou d’un calamar géant, smiley du Comédien tâché de sang devenant à la fin ketchup dans sa reproduction sur T-shirt, on en passe.
L’attraction formelle des motifs est donc héritée pour autant que sa série est reprise pour être poursuivie en étant richement alimentée par l’imagination dynamique du « showrunner ». L’œuf est cassé et son contenu bave dans plusieurs directions comme les tentacules d’un céphalopode géant. Les visages masqués des super-héros et les cagoules des fachos, la centrifugeuse quantique, la blague d’une brique tombant sur la tête et l’œil du cyclope en signe de reconnaissance du KKK qui fait signe vers le globe du calamar. Sans compter toutes les laitues, les œufs et les tomates qui balancent entre pomme d’or des Hespérides et pomme de la discorde lors de la guerre de Troie, découverte newtonienne et pomme du jardin d’Éden, organisme génétiquement modifié, cadavre de pendu et fruit pourri, la liste n’est évidemment pas exhaustive.
Avec Watchmen c’est Pâques, une fête du printemps qui n’oublie pas que son fond culturel est le sacrifice, la mort et la résurrection. Initiée par The Rocky Horror Picture Show (1975) de Jim Sharman d’après la comédie musicale de Richard O’Brien, la tradition des œufs de pâques, soit des « easter eggs » disséminés dans les productions des industries culturelles par les entrepreneurs avisés d’une adolescence prolongée, y atteint un paroxysme inédit. Les spectateurs sont dès lors invités à devenir des herméneutes postmodernes autant que les acteurs d’une stratégie publicitaire participative qui a trouvé un eldorado avec les créateurs de contenus dans le « YouTube Game ».
Pourtant, on le sait avec Gilles Deleuze et on ne se lasse pas de le répéter : on interprète moins en croyant cultiver un pouvoir sur l’œuvre à laquelle il manquerait un prêtre qu’on expérimente des rapports de sens en construisant la vérité de notre rapport à l’œuvre. L’œuf nourrit ainsi des fertilités contradictoires. D’un côté avec les pluies de seiche que lâche par intermittence le vieil Adrian Veidt en apparaissant comme la branlette d’un démiurge pervers et adulescent qui se rappelle au bon souvenir de l’humanité qu’il a sauvée du pire en le provoquant, morale jésuitique oblige. De l’autre avec la série des laitues, un végétal séminal autant lié à Min la divinité égyptienne et ithyphallique (la déesse hippopotame Taouret, protectrice de l’accouchement, présidait au destin de l’île de Lost) qu’aux épiciers du fascisme (le gang des choux-fleurs de Brecht est le contemporain des premières aventures de Superman créé en 1933 par Joe Shuster et Jerry Siegel).
Avec l’œuf est battu en neige le rappel établi par le biologiste William Harvey en 1651 : « Ex ovo omnia », « Omne vivum ex ovo ». Pas de naissance ex nihilo : nous naissons de l’intérieur. Dedans est une sphère que l’on perd à la naissance en lui substituant l’insufflation de sphères d’insulation techniques. Dedans est un jardin d’acclimatation dont les effets de serre peuvent produire d’abondantes écumes et conduire à ce que la couveuse finisse par devenir irrespirable. Les bouches alors salivent et le blanc qui monte en neige est devenu un poison. Les masques qui protègent l’anonymat des policiers les asphyxient en brouillant le sens de leurs missions quand ils étouffent leurs victimes. En face d’eux et avec Dylan Thomas on crie : « Aime-moi et soulève ton masque ! »
Watchmen la série est un surgeon de Watchmen le roman graphique : c’est un rejeton qui a poussé au pied de l’arbre. Dans l’intervalle, entre 1987 et 2019, le dernier acte parodique de l’affrontement géopolitique entre l’est et l’ouest a désormais cédé la place aux embrasements planétaires des violences auto-immunes, parmi lesquelles le prurit d’un terrorisme viral et d’un racisme systémique. Et l’Horloge de l’Apocalypse de marquer toujours minuit moins deux (et même moins une minute et quarante secondes avec la crise sanitaire provoquée en 2020 par la pandémie de Covid-19).
Si Damon Lindelof est une tête d’œuf bien remplie, elle l’est depuis l’adolescence par le double choc provoqué par le chef-d’œuvre d’Alan Moore et Dave Gibbons et la découverte trois ans plus tard de la série Twin Peaks de Mark Frost et David Lynch. Le narrateur qu’il est devenu est un artiste culinaire qui, c’est vrai, conçoit ses savantes et ludiques cosmogonies comme des omelettes. L’île de Lost est ainsi une image de l’œuf du monde chère aux mythologies indiennes et les naufrages et crashs qu’elle accueille dans son cul de poule valent comme un mélange de jaune, de blanc et de bris de coquilles.
Le narrateur est un chef cuisinier doublé d’un botaniste quand la série qu’il propose, en tirant un fil narratif inédit à partir de la matrice d’un univers préexistant, est un bourgeon qui se comporte par rapport à l’œuvre originale comme un greffon. Autrement dit, la série de Damon Lindelof fait de l’un des sauvageons du temps de son adolescence un porte-greffe sur lequel il exerce des effets rétroactifs d’altération. Avec un sens pervers de la cohérence, il s’amuse d’effets d’inversion de généalogie qu’il multiplie comme les tresses racinaires d’une corde ou d’un cordon. Lady Trieu, fille ignorée d’Adrian Veidt qui est issue d’un rapt de son sperme par sa femme de ménage vietnamienne, a cloné sa mère en la traitant comme sa fille. Angela Abar revit les aventures et mésaventures de jeunesse de son grand-père comme si elle les avait toujours déjà vécues. Jovan Adepo interprète le personnage de Will Reeves à l’époque des années 30. Dans The Leftovers il interprétait celui de Michael Murphy, le fils d’Erika Murphy incarnée par Regina King qui joue avec le rôle d’Angela Abar celui de la petite-fille de Will Reeves. Un pas plus loin et c’est Alan Moore lui-même qui apparaîtrait finalement comme le fils spirituel de son fils spirituel.
On le sait, Damon Lindelof connaît intimement le sens de son prénom. C’est pourquoi il est désormais le daïmôn d’Alan Moore après que J. J. Abrams l’a été pour lui avec Lost. Et qu’il l’a été mais d’une façon réciproque et continuée pour Tom Perrotta avec The Leftovers en inventant avec lui une première saison adaptant son roman suivie par deux saisons complètement originales. Le démon dont le génie révèle à son prédécesseur un accès inconnu à son œuvre est le disciple démonique dont la série empêche juridiquement son maître de reprendre la main sur son univers, qui reste la propriété de DC Comics. L’hypothèse de l’homosexualité du Juge Masqué, le super-héros le plus énigmatique de la première coalition des vigilantes ayant opéré entre 1939 et 1949 sous le nom de « Minutemen », n’est reprise et vérifiée que pour avérer qu’il faut aller encore plus loin. Qu’il y a, avec la naissance du premier d’entre tous les super-héros de Watchmen, la demande de justice d’un descendant d’esclave pendu par des fascistes ayant infiltré la police, et sa non prise en compte par son amant blanc, Nelson Gardner alias Captain Metropolis.
Sous la cagoule du super-héros, il y a un Noir lynché qui fait justice lui-même contre ses lyncheurs.
Damon Lindelof a compris Alan Moore quand ce dernier reconnaît dans les militants du Ku Klux Klan de Naissance d’une nation (1915) de David W. Griffith les premiers super-héros de l’histoire du cinéma, avec capes et masques en signes et marques de supériorité. Mais il est aussi son pire ennemi quand le super-héros retrouve des couleurs en changeant de couleur. Le supplément obscène de la loi est une figure rétrospectivement légitimée quand on la ramène au noyau d’une injustice raciale qu’il est enfin temps de reconnaître en faisant de la reconnaissance l’amorce d’une réparation.
Alan Moore se plaindrait peut-être du coucou qui a pratiqué dans son nid un parasitisme de couvée. Mais ce serait alors oublier que le scénariste l’aura toujours déjà pratiqué en pondant lui aussi des œufs dans des univers préexistants à l’instar de celui de Batman et du Joker, autres grands masqués délirants que suit de près le spectre de Guy Fawkes revenant dans l’original V pour Vendetta (1982-1990) avec le dessinateur David Lloyd.
Le crâne d’œuf se moque des têtes d’œuf, le sénateur Joe Keene jr. et Lady Trieu, qui ont le cerveau plus gros que le ventre comme la grenouille croit égaler le bœuf. Il cède cependant au réflexe d’un mimétisme des ressentiments qui renvoie tout le monde dos à dos, Hybris et Némésis, descendants respectifs des victimes et des bourreaux. Expurgée de ses graines de fascisme, l’institution policière se voit ainsi rechargée dans son autorité symbolique par une fiction qui, au fond, n’a pas le désir de remettre en cause ses violences structurelles. À cet égard, Watchmen est aussi consensuel que BlacKkKlansman (2018) de Spike Lee. Le sixième épisode intitulé « This Extraordinary Being » représente l’acmé de la série en dévoilant l’héritage inconscient d’Angela Abar qui devient désormais celui de l’univers original d’Alan Moore. C’est ainsi qu’est avérée la puissance rétroactive du surgeon quand il fait du sauvageon le porte-greffe dont il est le greffon. Mais l’épisode est porté par une forme tapageuse héritée de Birdman (2014) d’Alejandro González Iñárritu, roulements de tambour, faux plans-séquences et glissements des niveaux de réalité qui concassent les grandes problématiques de la loi formelle dont le vide est rempli par des contenus fascistes, de la justice hétérogène au droit, et de l’exception qui risque de confondre vengeance et réparation. Comme s’il ne fallait pas trop en demander non plus : que les africains-américains soient des policiers et des super-héros comme les autres.

Quant au neuvième épisode (« See How They Fly ») qui clôt Watchmen, il est un œuf saturé qui va trop vite en écrabouillant certains enjeux (il faut dire que ça écrabouille beaucoup dans la série, « Crushed Up » du groupe de rap Future l’annonce d’emblée). Damon Lindelof, s’il lance des pistes pour rire (l’identité de Lubeman) et d’autres moins (l’ambiguïté persistante du chef de police Judd Crawford), court toujours le risque comme Humpty Dumpty de tomber du haut de son muret en se cassant la tête sur le sol du confusionnisme (la transmission héréditaire de la mémoire et du génie et le mesmérisme des fascistes sont des hypothèses de science-fiction risquant d’obscurcir le rappel du massacre historique de Tulsa en 1921). Humpty Dumpty ressemble encore à un éléphant dans un magasin de porcelaine quand il n’offre aucun espace à Silhouette d’être autre chose qu’une silhouette justement. Issue de la première génération des « Minutemen », Ursula Zandt est une figure qui reste en effet non questionnée sur ses origines étrangères et le meurtre qui, le 12 octobre 1946, a sanctionné avec celui de sa compagne Gretchen Gruber la publicité de leur homosexualité.
L’historien William Blanc consacre à Ursula Zandt alias Silhouette quelques lignes dans Super-héros. Une histoire politique (éd. Libertalia, 2018), un ouvrage de référence qui, aussi passionnant soit-il, s’intéresse au fond peu à l’univers de Watchmen. Le paradoxe consiste même à ce que l’héroïne existe un peu plus dans le fameux générique-début de Watchmen (2009) de Zack Snyder dont Damon Lindelof ne veut pourtant rien savoir, et à raison parce que la version cinéma trahit le récit d’Alan Moore, notamment en ce qui concerne sa fin. L’arrière-plan brouillé où Silhouette est cantonnée bénéficie ainsi aux seules aventures croisées du Docteur Manhattan et du Juge Masqué qui vont se retrouver en s’accordant autour de l’idée que la traversée du miroir des masques blancs mène au lot commun des fraternités juives et des peaux noires martyrisées.
La contemporanéité du super-héros dont l’imaginaire spectaculaire est devenu hégémonique et des dernières résurgences du néofascisme est une coïncidence fatale quand elle ne peut pas ne pas faire sens. Il y a la possibilité de penser un rapport là où l’on penserait de prime abord qu’il n’y en aurait aucun. L’offre et la demande d’histoires de super-héros coïncident en effet avec l’exigence des policiers demandant un anonymat protecteur afin d’exercer un gardiennage héroïque dévoilant toujours plus l’obscénité surmoïque de la loi qu’ils sont censés représenter avec neutralité. Damon Lindelof a entendu Alan Moore mais le premier voit l’émeute du quartier de Greenwood et le massacre de Tulsa du 31 mai au 1er juin 1921 que le second n’aura pas vu. C’est le privilège des bourgeons qui sont des surgeons, et des surgeons qui sont des greffons en exerçant après coup leurs effets d’altération. C’est ainsi qu’il voit, avec le fascisme qui revient des années 30 et ses épiciers dont l’un des enfants vient de diriger la première puissance mondiale, que le massacre de Tulsa, tâche aveugle des représentations culturelles aux États-Unis, est peut-être aussi un enfant monstrueux de Naissance d’une nation dont la sortie a réveillé le KKK, ce dragon alors en sommeil.
Un enfant noir expulsé d’un cinéma d’Oklahoma où l’on projetait seulement pour lui les aventures fictives de Bass Reeves, premier authentique marshal africain-américain de l’histoire, est l’enfant expulsé de la projection d’un film que ni David W. Griffith ni son homologue noir Oscar Micheaux n’ont pu réaliser. Le cinéma muet est l’enfance de la si bavarde télévision et sa part muette – infans – recoupe la part maudite de ses représentations. Trust in the Law ! est un film fictif qui n’existe que dans une uchronie quand ce qui existe dans le monde des images de l’époque est le Lone Ranger, autrement dit Bass Reeves en version « whitewashing ».
« On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs » : c’est la question que Lénine s’est posée après la prise du Palais d’hiver et y a répondu Hannah Arendt en reconnaissant avec la morale jésuitique de la fin et des moyens un mal radical commun à tous les totalitarismes. « Les œufs se rebiffent » a-t-elle ainsi renchéri en s’inspirant d’un poème, « A War », de son ami, le poète et traducteur Randall Jarrell. Il est temps en effet aux œufs de se rebiffer quand on pense à ce pauvre Humpty Dumpty dont les mésaventures n’ont pas cessé de migrer entre une « nursery rhyme » de la fin du 18ème siècle et À travers le miroir (1871) de Lewis Carroll, entre « I Am the Walrus » des Beatles en 1967 et sa reprise par Spooky Tooth en 1970. Sans oublier le salut fraternel qui lui est adressé dans « Eggman » (1989) des Beastie Boys. Avec Humpty Dumpty, les têtes d’œuf qui sont des têtes dures risquent d’être toujours plus nombreuses à éclater par saturation dans une modernité arrivée à son stade hyperbolique et apocalyptique. Avec les ruines monumentales de sa culture qui crée moins qu’elle se reproduit, s’épuise et nous épuise à coups de séquelles et de préquelles, de spin-off et de reboot (Watchmen tient de l’un et de l’autre, par rapport à Alan Moore comme par rapport au film de Zack Snyder). Des « colchiques culturelles » comme en parle Diane Scott en se souvenant d’un poème d’Apollinaire et de son interprétation par Claude Lévi-Strauss, colchiques « qui sont comme des Mères / Filles de leurs filles ».
La tête de Damon Lindelof n’est pas épargnée par de tels effets de saturation mêlant chez lui rêve de régénération et fantasmes de filiation insensée, on le voit bien. C’est d’ailleurs pourquoi il s’amuse, autrement que Nick Park et Peter Lord avec Chicken Run (2000), à reprendre le paradoxe de l’œuf et de la poule évoqué par Denis Diderot dans son Rêve de d’Alembert (1769). Il peut ainsi rapporter l’omniscience du Docteur Manhattan, présent partout sur sa ligne de temps, au principe des prophéties autoréalisatrices dont les effets auto-réflexifs, partagés par bon nombre de sagas de la pop culture, entretiennent depuis une culture saturée d’elle-même le rêve asymptotique d’une auto-fondation symbolique. Entre l’œuf et la poule, il y a non seulement un effet de parallaxe qui pose que l’origine en amont de nous se tient aussi toujours devant (l’éternel retour est scindé en faisant revenir une différence originaire), mais il y a également l’insistance diabolique d’un fantasme d’inversion généalogique (Damon Lindelof est un enfant d’Alan Moore et l’inverse serait vrai).
Culture saturée des séries télé comme des chansons pop qui sont des paniers pleins d’œufs de pâques (« I Am the Walrus » et « Eggman »), au point d’en être effrayantes (en attestent la reprise d’un groupe nommé Spooky Tooth qui signifie la Dent effrayante, ainsi que le finale du morceau des Beastie Boys mêlant la musique de Jaws à celle de Psychose). Il n’en demeure pas moins vrai que le nègre (spook) reste le spectre (spook) de la modernité. Sa part scandaleuse et maudite pour citer Achille Mbembe l’est aussi dans les comics. Quand il ne cuisine pas des gaufres à ses enfants, Cal Abar joue aux fantômes, le corps recouvert d’un drap. L’enfance un jour viendra en ayant cette légèreté-là. En attendant, la cagoule et la corde retournées par la victime contre ses agresseurs qui l’ont pendue ont rappelé qu’au fondement caché du super-héros il y a le noyau d’un nihilisme placentaire.
La corde des pendaisons se déroule en révélant un cordon ombilical avec lequel les hommes qui veulent définitivement sortir de la nuit fœtale chercheraient compulsivement à en finir avec leur jumeau placentaire. Quand les omelettes sont raciales, l’homme brisé, qu’il soit juif, jaune ou noir, s’apparente toujours à une « hommelette » pour parler comme Jacques Lacan.
II. L’effet de parallaxe
est le fait des désaxés
« On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs » : la sentence est proverbiale, on la trouve déjà dans la bouche de Rorschach qui, dans le roman graphique, mène l’enquête sur la mort du Comédien. Il est beau en passant que le paria de la bande, le désaxé à l’enfance maltraitée et la tête farcie du chou du ressentiment, dévoile un anarchiste dont l’éthique lui rend insupportable l’idée défendue par Adrian Veidt/Ozymandias d’appliquer à l’ensemble de l’humanité la morale jésuitique de la fin et des moyens. Avec Rorschach, c’est comme si Cioran retombait sur Kant, quelle ironie. Et il aura été sur son chemin précédé par le Comédien qui aura su in extremis passer du ricanement cynique au rire tragique. C’est pourquoi Watchmen la bande dessinée et la série qui en hérite tiennent du genre impur, clivé et bariolé de la tragi-comédie, avec une histoire tragique, une action romanesque et une fin optimiste. La relève subjective d’un homme, qui abandonne ses fixations réactionnaires en assumant de mourir au nom de la vérité éternelle et sa publicité universelle, représente un sursaut éthique que s’appliquent consciencieusement à trahir ses héritiers auto-déclarés, les militants du 7ème de Kavalerie, extension uchronique du KKK.
Les intégristes oublient toujours que l’humanité, toute l’humanité, autrement dit tout le monde et n’importe qui, est plus importante que le séparatisme des identités paranoïaques et leur fétichisation despotique.
Avec Rorschach, on change de point de vue. Avec lui opère un effet de parallaxe. Dans cette perspective, la fidélité apparaît comme la pire des trahisons, avec Rorschach sorti de ses gonds réactionnaires et ses héritiers qui se leurrent en ratant le sens de cette sortie éthique. Alan Moore et Damon Lindelof ne peuvent pas ne pas y avoir pensé, même si l’on imagine leurs conclusions respectives radicalement diverger. Et puis, le second en aura autrement expérimenté la fièvre en étant désigné par les fans les plus intégristes de Lost à la vindicte d’avoir trahi le monde qu’il avait lui-même participé à créer et dont les « losties » seraient les meilleurs gardiens. Il s’agit d’ailleurs pour ce dernier d’une authentique obsession, à savoir la déception et le ressentiment qu’elle provoque en conséquence est une vague, un raz-de-marée qu’il faut pourtant affronter et surmonter en comprenant la différence décisive entre ne rien vouloir et vouloir le néant.
« On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs » : dans la série de Damon Lindelof, l’adage connaît deux occurrences et leur mise en rapport dialectique est riche de sens, c’est une écume. La première occurrence se trouve dans la bouche de Laurie Blake quand, à l’intérieur d’une cabine téléphonique longue distance appartenant à Lady Trieu, elle raconte une blague au Docteur Manhattan qu’elle croit comme tout le monde toujours en exil sur Mars. La seconde est dans les mots de Will Reeves qui prend soin des enfants de sa petite-fille Angela Abar dans un théâtre, le Dreamland, qui a été autrefois un cinéma projetant quand il était un enfant les aventures de son héros préféré, Bass Reeves.
Laurie Blake reprend délibérément les inflexions rhétoriques de Rorschach en racontant avec un machiavélisme savoureux une histoire drôle. La blague court sur l’ensemble de l’épisode et sa puissance parabolique est telle qu’elle rappelle à la parole elle-même qu’elle est toujours déjà parabole. Le mystère de la parole consiste en effet à vérifier qu’il est celui de l’identité de la parole et de la parabole quand la parole dit toujours plus et moins en disant toujours autre chose. La parabole qui dit étymologiquement un jet (bolê) à côté (para) est comme une tomate que l’on écrase à la figure du maître qui déçoit. Comme Adrian Veidt sur Europe mais son procès est aussi parodique que le paradis qu’y a créé le Docteur Manhattan en méconnaissant y avoir injecté ses propres angoisses (un manoir anglais en refuge provisoire contre l’horreur génocidaire). Parler c’est toujours parler à côté, c’est toujours parler en parabole, même à son corps défendant. La parabole est encore la brique oubliée d’une blague interrompue à l’autre qui diaboliquement la conclut, la brique qui finit par revenir de l’oubli en écrabouillant la tête de Dieu.
Le génie démonique de Damon Lindelof tient pour beaucoup dans ce goût qui remonte à loin dans l’histoire culturelle des apologues et la propension parabolique se prolonge avec le large éventail des chansons populaires employées. La parole est un mystère qui consiste à sauver le sens des messages cryptiques de Jésus pour ses apôtres et sa mise en lumière participe à sauver l’insaisissable pour Franz Kafka. Les êtres parlants que nous sommes sont mystérieux les uns pour les autres en étant justement partagés par le fait même de parler. La parole est ce mystère qui demande avec son initiation une certaine qualité de silence (muéô signifiant en grec initier vient de múô signifiant fermer). L’enfance, avec l’infans en son cœur, est le moment fort et intuitif de saisie de la connivence extrême de la parole et de la parabole.
Dans l’œuf de la blague, il y a une image de vérité concernant les têtes d’œuf qui projettent dans le ciel de grandes idées en ignorant que celles-ci, par un effet feed-back ou boomerang, vont leur revenir à la figure. On n’a pas oublié le regard d’Evangeline Murphy au début de la troisième saison de The Leftovers. L’adolescente regarde alors tomber du ciel le drone explosif qui se reflète dans ses lunettes en reflétant la hargne qui aura contribué à son lancement. Il y a également pour la géniale narratrice de la blague une adresse amoureuse et pudique qui touche à son noyau divin quand l’autre qui ne répond pas s’apparente au Très-Haut, au Tout-Autre dont on guette le moindre signe. Mais le grand Autre n’existe pas et le Docteur Manhattan qui a refusé le mandat d’être un nouveau dieu se cache à quelques pâtées de maison de là, enfoui dans le corps amnésique d’un homme qui ne l’aime plus depuis longtemps.
Ce qui tombe du ciel n’est pas un présent d’amour venu de Mars mais la carcasse d’une voiture, une ferraille manipulée dans l’ombre par Lady Trieu – « Space Junk » relie ainsi une chanson de Devo au godemiché dont use Laurie en vivant ainsi l’absence de God. Ce qui tombe du ciel est encore la brique d’une petite fille pleine de ressentiment qui, en tuant Dieu oublieux de sa présence, met un terme inconscient à l’amour de l’homme considéré comme un dieu, on y reviendra.

« On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs » : la sentence proverbiale signe autant la morale jésuitique d’Adrian Veidt arrêtant le sacrifice de trois millions de New-yorkais pour sauver la planète d’un affrontement nucléaire imminent, qu’elle appartient à la femme qui ne peut pas ne pas faire des blessures l’épreuve existentielle d’un destin. Watchmen raconte la sublime histoire d’amour d’Angela Abar et du Docteur Manhattan, autant que la fin de celle de Laurie Blake pour ce dernier, non moins émouvante mais plus discrètement. Pour Laurie, l’amour déçu est loin d’amplifier son ressentiment qui est le venin alimentant sa traque des super-héros en incluant ceux qui se cachent dans les rangs de la police. L’amour est moins déçu que disparu et sa disparition la porte au contraire à s’ouvrir à la vérité et sa publicité en trahissant le secret d’Adrian Veidt. Lui qui est toujours persuadé d’être le bienfaiteur ignoré du genre humain est un patriarche qui arrose régulièrement ses enfants de sa semence infertile et violacée de puceau prolongé.
L’adage des œufs et des omelettes semblerait avoir été popularisé en France par une nouvelle d’Honoré de Balzac intitulée Adieu (1832) et il pourrait disposer d’un autre sens rompant avec la morale de la fin justifiant les moyens, rapportée par Eugène Sue au jésuitisme comme le raconte Umberto Eco dans Le Pendule de Foucault (1988). Autre effet de parallaxe, qui associe dans le même mouvement Laurie Blake à sa rivale Angela Abar quand le grand-père de cette dernière évoque à son tour le sort des œufs et des omelettes en indiquant dorénavant moins la nécessité du mal radical conçu par Kant que celle de l’amor fati chéri par Nietzsche qui n’a pas oublié la leçon des stoïciens.
La parallaxe signifie en grec changer de place, altération, mouvement alternatif, déplacement (allo dit autre, axis dit axe ou essieu) à côté (para). Voilà bien ce que l’on demande à une œuvre d’art : qu’elle nous invite à changer de place en voyant les choses d’un jour neuf, avec un regard renouvelé. Ainsi, on se souvient avoir vu dans The Leftovers l’image d’un passage nécessaire entre anus mundi et axis mundi à partir d’une perspective où le trou provoqué par la « Soudaine Disparition » du 14 octobre 2011 n’est pas tant ce qu’il faut combler de l’excrément des cadavres de l’humanité restante, mais le vide autour duquel il faut apprendre à tourner en préférant à la chute dans le puits la tenue persévérante de sa margelle. De l’anus à l’axis, le monde devenant toujours plus immonde redevient habitable à partir des retrouvailles avec l’omphalos. Le centre mythique du monde ressemble moins au nombril des narcissiques qu’à l’ombilic de ceux qui se savent les sujets d’une castration originaire en ayant été avant leur naissance reliés au premier compagnon des profondeurs, le médiateur évanouissant de la nuit fœtale : le jumeau placentaire.
Le vide hérité avec la naissance qui se double de la délivrance, autrement dit de l’expulsion du placenta ou du délivre, est ce qui permet d’être ouvert à ce qui arrive et celui ou celle qui vient, dans la balance de la croyance en soi et de la confiance en l’autre plutôt que dans les surenchères de la méfiance et du discrédit qui conduisent à la crise mimétique. La relève du nihilisme placentaire se tient dans une éthique dyadique. Le vide qu’il y a à l’intérieur d’une sentence proverbiale est ce qui en fait boiter le sens qui claudique entre la morale jésuitique et l’éthique des moyens purs, entre la vengeance pulsionnelle et l’impuissance consentie. Cette claudication appartient aussi à Lénine contre la révision critique de Hannah Arendt, quand le dirigeant bolchevique sait qu’il doit prendre des décisions pour l’avenir de la Révolution en assumant son sens et son destin depuis les blessures infligées au peuple russe d’une guerre mondiale ravageant l’Europe et d’une antique féodalité.
La parallaxe définit scientifiquement l’incidence du changement de position de l’observateur sur l’observation d’un objet donné. On s’est tous amusés, enfants, à regarder les horloges indiquer une heure différente en fonction de la variation de la position adoptée. Slavoj Žižek est le philosophe contemporain qui en a tiré un concept dans un souci de renouvellement de la pensée hégélienne (le passage dialectique du particulier à l’universel, de l’universel abstrait à l’universel concret) et du matérialisme marxien (la valeur capitaliste se dissocie en valeur d’usage et valeur d’échange, en rapports de production et en forces productives), à la lumière de la psychanalyse lacanienne (le réel nomme l’écart disjonctif du symbolique dont la non clôture induit la multiplicité conflictuelle des points de vue). Si l’écart est dit parallaxique ou parallactique, ce n’est donc pas tant en insistant sur le sens de la différence existant entre deux termes hétérogènes qu’en indiquant décisivement l’antagonisme logé dans tout objet dès lors qu’il est le sujet d’un regard.
La non-coïncidence de l’objet avec lui-même informe que l’antagonisme est toujours déjà dans l’œil de l’observateur. La différence est la plus pure quand elle introduit ou réintroduit la différence dans l’identique en rappelant au sujet la barre oblique qui, justement, en constitue la subjectivité.
Le rappel de cet antagonisme refoulé, qui recoupe aussi l’oubli moderne et nihiliste du vide laissé par le jumeau placentaire, fait tout le sel et le prix des séries de Damon Lindelof. Avec la parallaxe, ses grandes machines narratives, fourchues comme la jungle d’une île introuvable du Pacifique, avec des tentacules aussi multiples que celle d’un calamar géant digne de Jules Verne, ont la possibilité philosophique de revenir du stade postmoderne du relativisme (la diversité concrète des points de vue induit avec leur équivalence abstraite une interchangeabilité ludique mais confuse) à la modernité du perspectivisme (la vérité qui est celle de l’antagonisme concret s’expérimente dans une variété conjonctive de points de vue disjonctifs), sans basculer dans l’hyper-modernité et ses excès qui sont des exacerbations apocalyptiques. Héritier d’Alan Moore qui a écrit Watchmen en ayant probablement en tête le modèle narratif donné par Citizen Kane (1941) d’Orson Welles (l’enquête de film noir et les archives de fiction, la multiplicité des perspectives et l’arrière-fond historique, la modernité capitaliste, ses extensions médiatiques et son vieux fond féodal et despotique), héritier aussi de Henry James et Jorge Luis Borges autant que de Jules Verne, Damon Lindelof est un explorateur savant de la culture saturée de notre temps. Et s’il y participe comme Federico Fellini participait de la décadence qu’il filmait, ses plongées sont toujours des catabases dont les bifurcations éclairent la part de mythe dans la rationalité moderne et technique, ainsi que la part d’ombre dans les représentations dominantes qui est une part maudite, mal vue et mal dite.
Écarts parallactiques de la sentence proverbiale sur les œufs et les omelettes dont la fourche distingue la morale jésuitique de l’amor fati, mais aussi des gaufres pour les enfants et des omelettes pour les adultes blessés qu’ils deviendront. Écarts parallactiques de l’histoire drôle qui livre à la fois un art poétique et une adresse amoureuse, un apologue sur la parole comme parabole et une image de vérité pour toutes les têtes d’œuf ayant oublié qu’elles rejouent le destin de Humpty Dumpty. Écarts parallactiques de l’œuf et de la poule dont le paradoxe conjoint à l’éternel retour de la différence originaire un fantasme d’auto-fondation symbolique qui découle d’une culture saturée. Écarts parallactiques du Juge Masqué qui se révèle non pas blanc et homosexuel mais noir et bisexuel, comme de Cal Abar cachant dans son corps l’esprit du Docteur Manhattan qui, avant de l'être, a été un enfant juif allemand répondant au nom de Jon Osterman. Écarts parallactiques de Will Reeves qui a changé de nom en adoptant celui de son modèle Bass Reeves qu’il a pourtant trahi quand il découvre que la loi est infiltrée par la pègre suprémaciste, et de sa petite-fille Angela Abar qui se ressouvient grâce à lui qu’il y a, logée dans son désir de police, la part refoulée et surmoïque d’une vengeance enfantine. Écarts parallactiques du terroriste vietnamien exécuté avec une cagoule sur le visage comme des militants du KKK pendent aux arbres leurs victimes, et de la petite Angela dont les parents africains-américains apparaissent aux yeux de certains autochtones comme les occupants de leur pays, le Vietnam, depuis qu’il a été en 1971 annexé par les États-Unis.
La parallaxe, Damon Lindelof en a apprécié les vertiges dans un film fondateur, À cause d’un assassinat (1974) d’Alan J. Pakula, chef-d’œuvre du thriller paranoïaque des années 70 dont le titre original est The Parallax View comme le livre de Slavoj Žižek. Avec la parallaxe déjà à l’œuvre dans le roman graphique d’Alan Moore, la citation du satiriste romain Juvénal (« Quis custodiet ipsos custodes ? ») fait dès lors entendre deux sens différents et antagoniques : « Qui protège les gardiens ? » est la question posée par la société en devant assurer à ses protecteurs une forme appropriée d’immunité ; « Qui surveille les gardiens ? » est l’autre question que se pose la même société quand ses surveillants font de l’immunité une impunité en agissant comme des auto-anticorps. La parallaxe renseigne encore sur les antagonismes intrinsèques au genre de l’uchronie, dont l’imaginaire use du mode conditionnel pour interroger de façon critique les potentialités du présent, propension totalitaire des États-Unis et résurgences identitaires et fascistes. Le risque bien réel de la confusion du fictif et du factuel (le massacre historique de Tulsa se voit bordé d’un côté par le mesmérisme des suprémacismes, de l’autre par la transmission héréditaire de la mémoire ou du génie) se distingue cependant du jeu puéril des compensations fantasmatiques proposé par Quentin Tarantino, plus adulescent au fond que Damon Lindelof, dans Inglourious Basterds (2009) et Once Upon a Time... in Hollywood (2019).
Dans la perspective parallactique, la modernité nomme l’antagonisme, autrement dit le réel conflictuel que ne gomment ni la postmodernité inconséquente et ludique ni l’hyper-modernité avec ses excès et ses effets de saturation hyperbolique.
Dans Watchmen la série, l’écart parallactique des couleurs est celui des identités raciales (le bleu est la couleur de recoupement symbolique d’une question juive et d’une question noire). Les super-héros qui incarnent le supplément problématique d’une loi qui ne suffit pas par elle-même en autorisant ses exceptions parfois illégales sont des figures de désaxés, à la fois bouffons incarnant la parodie de la loi et pervers ou psychopathes qui en profitent en en tirant d’obscènes jouissances. Ils le sont autrement quand leur histoire se noue à celle du fascisme des années 30 considéré dans toutes ses facettes et selon toutes ses perspectives, antisémitisme pour Superman, racisme anti-noir pour le Juge Masqué et leur convergence fraternelle accueillie dans le corps de Cal Abar. Si les super-héros sont si présents et hégémoniques aujourd’hui, serait-ce alors aussi parce que revient le fascisme ? C’est le rapport qu’il nous faut penser et que la pharmacie de Watchmen nous aide à panser.
Une dernière parallaxe, qui n’est pas la moins émouvante même si elle est moins exposée, plus discrète. Elle concerne Wade Tillman, un policier de Tulsa connu sous le sobriquet de Looking Glass. Le jeune Témoin de Jéhovah qui a survécu au canular réellement catastrophique d’Adrian Veidt lancé sur New York dans la nuit du 2 novembre 1985 est depuis un adepte du survivalisme qui craint la répétition du pire. Le personnage de Wade joué par un gars du pays, Tim Blake Nelson, ressemble à ce titre aux membres des « Guilty Remnant » dans The Leftovers. On se souvient en effet que les « Reproches vivants » signifient à l’humanité restante qu’il ne sert plus à rien de vivre comme avant dès lors que l’événement de la « Soudaine Disparition » représente un coup de semonce en préparation du pire et il arrive bien mais en étant seulement précipité par leur volonté de néant. Sauf que l’événement est réel mais indécidable dans The Leftovers, quand il est un simulacre dans Watchmen, quand bien même ses effets ont été réellement et massivement meurtriers.
Wade Tillman est préposé aux analyses comportementalistes et, malgré sa placidité et sa lucidité, il va pourtant se faire berner parce qu’il reste un sentimental, un vrai. Comme le Docteur Manhattan dont le bleu indique aussi par la bande quelle est au fond sa couleur préférée. Berné, Wade l’a tôt été, adolescent fichu à poil par une punkette qui s’est moquée de lui en l’abandonnant dans un palais des glaces de la fête foraine de Hoboken. Les miroirs qui ont alors réfléchi à l’infini la honte de sa nudité ont pourtant servi de cocon protecteur face à l’onde de choc psychique suscité par le cerveau désintégré du calamar géant créé par Adrian Veidt et téléporté sur New York. L’homme de la nudité traumatique se cache depuis le visage en renvoyant aux autres le visage de leur nudité déniée. Ariane qui a perdu Thésée dans le dédale de son désir l’aura pourtant sauvé du volontarisme jésuitique des hommes qui font le bien en usant des pires moyens. Le « born again » l’a été une nouvelle fois, mais autrement et cela est un événement, la blessure dont Wade doit tirer un destin comme Joë Bousquet a fait du projectile reçu en 1918 l’événement de sa poésie.
Le masque constitue en soi un écart de nature parallactique en recouvrant ce qu’il renvoie aux autres : c’est-à-dire la honte des visages qui trompent en ne cessant de miroiter la vérité, spéculaire toujours et parfois de manière spectaculaire, de leur tromperie.
La nudité est un mystère quand elle expose ce qu’elle défend. En dévoilant ce qu’elle garde voilé, elle tient de l’être du secret comme Anne Dufourmantelle y a à juste titre insisté. Comme la parole et sa vérité parabolique, la nudité est un mystère partagé par le Docteur Manhattan comme par tant de personnages de Damon Lindelof, dans The Leftovers (Kevin Garvey père et fils, Nora Durst et Evangeline Murphy) comme dans Lost (surtout Desmond David Hume). Parole et nudité sont des mystères en invitant à se désaxer, c’est-à-dire à changer de place pour changer de regard, autrement dit à faire de la parallaxe la relève de la vieille dialectique en lui offrant de nouvelles perspectives.
III. Aime-moi et soulève ton masque,
les blessures ont besoin de respirer
Dans La Parallaxe, Slavoj Žižek rapporte l’anecdote suivante. Si elle est éclairante sur ce que le philosophe slovène désire signifier en développant un concept de parallaxe ou d’écart parallactique, elle est particulièrement saisissante pour ce qui nous concerne. En 2001, l’Argentine connaît une grave crise économique déterminée par une dette dont la bulle a tant gonflé qu’elle est devenue asphyxiante pour tout le pays. Un mouvement social d’ampleur a manifesté une telle puissance de soulèvement populaire qu’il a provoqué le départ du ministre de l’économie, Domingo Cavallo, identifié comme l’un des architectes des politiques néolibérales qui ont mené l’Argentine à la banqueroute. C’est alors que l’anecdote se fait apologue. C’est en effet à cet endroit-là que l’histoire fait mousser des puissances paraboliques propres quand on découvre que, pour disparaître au milieu des foules qui réclamaient sa démission et pouvoir ainsi prendre la fuite, le ministre a arboré un masque à son effigie comme alors il en existait beaucoup afin de le tourner en ridicule.
Le lecteur avisé de Hegel et Lacan conclut ainsi son histoire, aussi désarmante que celle de Laurie Blake : « Il semble ainsi que Cavallo ait au moins appris quelque chose du mouvement lacanien largement répandu en Argentine : le fait qu’une chose est à elle-même son meilleur masque. La tautologie nous met en présence de la différence pure, non pas la différence entre un élément et les autres, mais la différence de l’élément vis-à-vis de lui-même ».
On s’en étonne et, en même temps, pas vraiment quand, au début du huitième épisode et avant-dernier épisode de la série (« A God Walks into Abar »), le Docteur Manhattan entre dans un bar de Saïgon pour y séduire une policière célibataire d’origine africaine-américaine avec, sur le visage, un masque à sa propre effigie. Nous sommes alors en 2009 et le moment est à la célébration contrastée de l’annexion du Vietnam par les États-Unis. Mais la policière est sombre, elle est retirée dans ses pensées. Elle songe à autre chose en ayant en tête la mort de ses parents provoquée par un attentat terroriste le jour d’une précédente célébration remontant au milieu des années 80. L’homme qui entre dans ce bar sait tout cela, il sait déjà qu’il aime cette femme qui ne le connaît pas et elle l’aimera en croyant même pouvoir le sauver alors que tout est fichu, cela aussi il le sait. Mais le dieu qui a refusé de l’être après avoir servi d’arme de destruction massive à l’impérialisme de son pays d’adoption s’est absenté depuis. Le dieu absent et démissionnaire ne peut donc pas ne pas revenir comme cela. C’est pourquoi il arbore un masque à son effigie en se faisant passer pour ce qu’il n’est pas, montrant ainsi qu’il est par essence ce qu’indiquent les apparences.

Effet de parallaxe garanti, celui de la tautologie dont le frisson fait remonter des redondances la différence pure, comme la mousse au sommet du verre de bière. Bleu sur bleu comme Kasimir Malevitch a peint, après « Carré noir sur fond blanc » en 1916, « Carré blanc sur fond blanc » en 1918, en expérimentant à la surface de la toile la différence pure ou essentielle, celle que Marcel Duchamp a pour sa part retraduit du terme d’inframince. Quand la différence est évanouissante, note Alain Badiou dans Le Siècle (2005), alors l’assomption est soustractive en opposant à la destruction maximale une différence minimale. Comme de juste, « Carré blanc sur fond blanc » est un tableau que Slavoj Žižek évoque dans La Parallaxe en y reconnaissant une grande image de l’écart parallactique.
La parallaxe est d’abord facétieuse, limite graveleuse, quand elle détermine le dédoublement stratégique du titre de l’épisode en question (« A God Walks into a Bar » est le titre d’avant diffusion, « A God Walks into Abar » après). Elle se joue aussi dans le motif récurrent chez Damon Lindelof de l’anniversaire qui, si l’on sort du cercle infernal du nihilisme placentaire, invite à comprendre en compagnie du philosophe Peter Sloterdijk que, dyade oblige, les anniversaires sont gémellaires. La fête du présent se double toujours de celle de l’absent. La parallaxe se tient encore et décisivement dans le motif du masque dont la question revient très fort ici quand elle ne cesse pas d’être évacuée ailleurs, et de manière très problématique, jusqu’à finir par être quasiment neutralisée dans les adaptations cinématographiques labellisées Marvel ou DC Comics produites durant la dernière décennie. Si le masque n’y est plus opératoire, c’est qu’il n’y a plus ni écart parallactique de l’essence et des apparences, ni schizoïdie des identités plurielles et conflictuelles. C’est qu’il y a la réflexologie des identifications automatiques à des super-héros qu’il faut sauver à tout prix en sauvant l’obscénité qui, fondamentalement, les caractérise. Sauver leur obscénité c’est la conserver en garantissant au spectateur postmoderne de pouvoir jouir en toute hypocrisie : et du principe de réalité (le super-héros reste le gardien de la loi morale) et du principe de plaisir (le gardien ne l’est qu’en ne cédant rien sur l’impératif du surmoi consistant à prendre son pied). Suicide Squad pour DC Comics, Deadpool pour Marvel et la série The Boys adaptée d’un comics et diffusée sur Amazon en représentent les ultimes manifestations et il faut leur opposer Watchmen.
On peut d’abord commencer par revenir sur ce que le masque à l’origine signifie, masca en vieux latin qui a donné mascara et mascarade. Le masque tient donc de la cosmétique et du carnaval et l’erreur consisterait à lui opposer la pseudo-naturalité des visages et de leurs détenteurs, autrement dit l’authenticité des personne quand persona désignait à l’époque romaine le masque du théâtre (le verbe personare signifie résonner ou retentir parce que le masque servait alors de porte-voix). Porter un masque n’induit pas l’exigence de son dépôt afin de révéler le vrai visage qu’il cache. Le masque est plus sûrement un voile qui montre la vérité en disant qu’il n’y a pas plus duplice qu’un visage. Le visage et le masque coïncident à partir de ce qui les différencie et c’est une coïncidence fatale, une boiterie pour tous les personnages qui mentent aux autres parce qu’ils se mentent toujours déjà à eux-mêmes. Déposer le masque n’appelle pas tant la révélation des identités personnelles cachées, mais le dévoilement des blessures qui, comme le souffle génialement Will à Angela, ont besoin d’air pour respirer et cicatriser. Y compris les plaies les plus intériorisées.
Angela Abar ment aux autres en se mentant elle-même quand la loi qu’elle sert et défend lui permet aussi de cultiver des pulsions autoritaires et vengeresses dont les racines plongent dans son enfance blessée. En trompant elle se trompe sur elle-même. Elle arrive cependant à accéder à la vérité qui relève moins du complot objectif (ce n’est pas la part la plus intéressante de la série) que de la conspiration intérieure organisée par sa psyché (l’histoire de son grand-père l’habite compulsivement, elle en est le siège inconscient et cryptique).
Sister Night est la « nun with a motherfucking gun » pour autant qu’elle est vraiment la fiancée sadomasochiste d’un dieu caché. En passant, Sister Night est certes le titre fictif d’un genre de fantaisie, la « maxploitation », qui démarque le genre réel de la « blaxploitation » (le genre où les héros sont noirs se double de celui où ils sont aussi des super-héros masqués), mais il permet de comprendre l’origine du patronyme Abar quand on découvre l’existence d’un film comme Abar : The First Black Superman (1977) de Franck Packard. On sait également qu’Alan Moore, en travaillant sur le personnage du Juge Masqué, a ébauché l’idée d’un super-héros qui aurait été connu sous le pseudonyme de Brother Night. Will Reeves, le grand-père d’Angela, ment également quand il se fait passer pour un Blanc en prenant la défroque du Juge Masqué mais ce blanchiment a pour négatif le « whitewashing » qu’incarnerait le Lone Ranger par rapport à Bass Reeves. S’il dit la vérité (la corde et la cagoule que je porte, je les ai prises à mes ennemis), il se ment à lui-même en ne reconnaissant pas que sa demande de justice se confond avec une exigence de vengeance dont a hérité sa petite-fille en participant sans le savoir à sa relance, loop de la prophétie auto-réalisatrice oblige.
Looking Glass est un autre exemple intéressant puisque Wade Tillman fait de l’effet miroir induit par sa cagoule argentée, avec la matière luisante qui la recouvre (« reflectatine »), le tain qui soustrait son visage du rapport de face à face ou du vis-à-vis. Le retrait du visage est une soustraction en effet, une réserve aussi, qui vérifie la rupture narcissique de la cordialité interfaciale introduite par l’individualisme moderne et sa propension au nihilisme placentaire. Quand le visage d’autrui a perdu son caractère d’épiphanie, il n’est plus qu’un masque renvoyant chacun d’entre nous à une dyade mutilée, une monade psychotique. Laurie Blake et Adrian Veidt qui appartiennent à la génération précédente des vigilantes en savent un peu plus sur la question. Cela ne les empêche pas de se fourvoyer sur eux-mêmes : elle qui pourchasse les super-héros en leur faisant subir une foudre qui est le vinaigre d’un ressentiment longtemps ruminé ; lui qui vit son séjour sur Europe à proximité de Jupiter comme l’exil d’un bienfaiteur de l’humanité déçu de n’avoir pas été reconnu comme tel par elle. Il n’empêche, la première sait bien qu’il n’y a aucune différence entre un vigilante interdit par la loi fédérale et un policier dont l’anonymat est protégé par une législation propre à Tulsa. Le second n’ignore pas moins qu’avoir affublé d’un masque le garde-chasse qui protège les limites du domaine de son exil aura servi à le rendre plus cruel dans l’accomplissement de son mandat. Cruel qu’il aurait été toujours déjà de toute façon parce que, premier d’entre tous les clones créés sur Europe par le Docteur Manhattan en parodie du couple adamique de la Genèse, il lui manque sa moitié. Au premier Mister Phillips fait en effet défaut sa Miss Crookshanks.
Dans Watchmen, il y a à propos du masque un argument de circonstance : « Defense of Police Act » (DOPA) est le nom d’une législation uniquement valable sur le territoire de Tulsa et elle autorise les policiers à opérer en cachant leur identité depuis qu’ils ont été visés par une série d’attentats meurtriers le soir du réveillon de Noël 2016. Si cette nuit blanche est qualifiée de « white night », c’est en rappelant que la plupart des victimes étaient noires et blanche la totalité des assaillants. On doit ce dispositif au fringant sénateur Joe Keene dont le père, John Keene, avait fait adopter à la suite d’une grève des policiers une disposition inverse consistant en 1977 à frapper d’illégalité les vigilantes. Le fils rêve de la présidence toujours occupée par Robert Redford, pendant libéral du conservateur Ronald Reagan mais son mandat, marqué par des politiques progressistes, est celui de l’exception devenue la règle puisqu’il est au pouvoir depuis 1993. C’est, avec la comédie musicale Oklahoma ! (1943) de Richard Rodgers et Oscar Hammerstein II repeinte en noir et la série dans la série American Hero Story affublé des avertissements moquant le « politiquement correct », un autre effet de parallaxe qui contrarie tous les pourfendeurs du « wokisme ».
Joe Keene est pourtant un digne héritier de son père en incarnant avec la tendance « alt-right » de la politique intérieure étasunienne le backlash réactionnaire exemplifié par l’accession au pouvoir de Donald Trump. Le dispositif du DOPA se révèle un piège puisqu’il excite la surenchère mimétique des fascistes qui se reconnaissent dans la cagoule de Rorschach et des flics qui ne peuvent s’empêcher de jouer aux justiciers masqués. Un homme providentiel pourrait remporter la mise, surtout s’il met la main sur le Docteur Manhattan et ses super-pouvoirs. Mais le suprémaciste a un rival mimétique en la personne de Lady Trieu, meilleure marionnettiste que lui. Son rêve de paix perpétuel revêtu d’une glorieuse ancêtre, Triệu Thị Trinh, la combattante vietnamienne de l’invasion chinoise à l’époque du 3ème siècle de notre ère, cache en effet d’obscurs desseins totalitaires en ressemblant tellement à la grosse brique de la blague qui, nécessairement, lui retombera avec grand fracas sur la pomme.
Dans Watchmen comme dans les précédentes séries de Damon Lindelof, il y a surtout un jeu de masques, de volte-face et d’identités multiples que l’on s’épuiserait à lister de manière exhaustive. Que l’on songe déjà aux personnages de Sawyer (en fait James Ford) et de Kate Austen dans Lost, qui changent d’identités comme les serpents de peaux. Que l’on pense encore à Kevin Garvey qui se fait appeler Harvey lors de ses fugues schizophréniques et chamaniques (moins pour citer le biologiste William Harvey qu’en référence à Lee Harvey Oswald, l’assassin de J.F. Kennedy).
C’est un feu d’artifices, un festival de masques dans Watchmen. Ainsi, Will Williams se fait appeler Will Reeves en hommage au héros de son enfance, le marshal noir Bass Reeves, et se fait connaître avec le pseudonyme de Juge Masqué. Le redoublement du W est un signe caractéristique des héros des univers DC et Marvel (par exemple Peter Parker ou Bruce Banner et Lex Luthor ou Loïs Lane), quand le nom de Reeves rappelle celui des interprètes de Superman, George Reeves à la télévision et pour le cinéma Christopher Reeve (attention, sans la lettre S... comme Superman). Du côté de Laurie Blake, on découvre qu’elle a désormais adopté le nom de son père, Edward Blake alias Le Comédien, après avoir porté le nom anglicisé de sa mère d’origine polonaise, Sally Jupiter ex-Juspeczyk, qui s’était fait connaître avec l’habit du Spectre Soyeux. Cette manière hétérodoxe de réhabilitation de l’homme qui a pourtant violé sa mère signe le caractère brut de décoffrage de Laurie Blake (une Laurie qui aura été précédée par son homonyme dans The Leftovers, Laurie Garvey). Laurie Blake est génialement interprétée par Jean Smart et son regard trouble en étant comme glissé de biais, jeté un peu à côté, en lui-même toujours déjà parabolique.
C’est encore plus fort avec Cal Abar qui est le nom de la personne d’emprunt du Docteur Manhattan caché du monde au nom de l’amour d’Angela, en gardant au fond de sa mémoire verrouillée par l’amnésie le fait qu’il s’est appelé Jon Osterman jusqu’à l’accident nucléaire de Gila Flats le jour du 20 août 1959. Avec Cal Abar qui se nommait Calvin Jelani avant de mourir, l’onomastique fait monter une écume très suggestive : Calvin Jelani signifie le chauve en latin et le puissant en swahili, ce qui convient bien au teint du dieu bleu créole ; le prénom Calvin est riche de sens, de l’un des pasteurs emblématiques du protestantisme au prénom Kelvin, récurrent dans l’univers de l’ami J.J. Abrams en étant celui de son grand-père. Cal Abar fait encore signe du côté d’Excalibur qui est le nom du godemiché azur de Laurie confectionné par son ancien compagnon toujours incarcéré, Dan Dreiberg connu sous le nom de Hibou II. On verra que le Roi pêcheur n’a pas d’autre Graal à garder que la blessure de son cœur, une fleur bleue dont le rayonnement s'exerce jusque sur un gode.
Cal Abar fait également signe vers une fève toxique originaire du Nigeria : surnommée le « haricot de l’ordalie », elle servait à faire la preuve de l’innocence d’individus soupçonnés de crimes comme la sorcellerie. Les pilules « Nostalgia » qui permettent à Angela de revivre les souvenirs synthétisés de son grand-père auraient une fonction voisine quand le Nigeria apparaît à l’occasion de l’une des lectures de Cal, Tout s’effondre (1958) signé du romancier nigérian Chinua Achebe (et, avec le récit d’Okonkwo, la figure du pendu). Enfin, last but not least, Cal Abar est le nom d’un homme qui, en portant celui de sa compagne, figure une belle inversion du modèle patriarcal traditionnel. Et puis ce gag pour les amateurs chevronnés d’œufs de pâques : l’interprète d’Angela Abar, Regina King, a joué dans la sitcom 227 (1985-1990) une adolescente amoureuse d’un certain... Calvin.
Multiplicité conjonctive et disjonctive des noms, des masques, des identités, des perspectives et des généalogies : à l’origine toute genèse est « digenèse » aurait dit Édouard Glissant, dyade de dyade aurait relancé Jacques Derrida ; à l’origine il y a un écart différentiel dont les effets parallactiques attestent que la différence est une déhiscence qui ne cesse pas de faire retour éternellement. C’est ainsi que Watchmen la série se sépare de Watchmen le roman graphique en dévoilant au second le caché que le premier aura en lui projeté comme par un effet de rétroprojection. Avec le changement d’axe de la parallaxe, l’uchronie permet d’ouvrir une nouvelle perspective en dévoilant la part nègre qui a été scandaleusement refoulée dans la modernité, y compris dans celle du super-héros.
Il y a toujours une dialectique des peaux noires et des masques blancs, voilà l’actualité intempestive de Frantz Fanon vérifiée par la série de Damon Lindelof en nous rappelant que le premier ouvrage du psychiatre martiniquais a été écrit dans une époque marquée par la découverte des horreurs de l’antisémitisme génocidaire nazi et du soulèvement des peuples contre le colonialisme dont l’Indochine a été la première scène, matrice du conflit vietnamien. Sous la peau bleue du Docteur Manhattan il y a une peau noire et sous elle se cache le cœur du fils d’un horloger juif allemand ayant fui le nazisme. « Black Lives Matters » clament aujourd’hui les militants qui luttent aux États-Unis contre le racisme systémique de la police et leur répondent les policiers avec un hashtag mimétique, « Blue Lives Matters ». Après tout, le Rhapsody in Blue (1924) de George Gershwin a inspiré l’ouverture de « Saddest Tale » (1934) de Duke Ellington avant de motiver en 1977 sa reprise funk par Walter Murphy.
Les délires identitaires ne tiennent qu’à la forclusion forcenée de la créolisation du monde.
L’époque actuelle est à la tragi-comédie : de Hegel à Marx, la tragédie s’est à force de répétitions muée en farces en série. Elle est désormais à la parodie dont Giorgio Agamben a bien noté dans Profanations (2005) qu’elle fonctionne à l’opposé de la fiction qui remet en question la réalité de son objet. La parodie se tient quant à elle à distance d’une réalité insupportablement réelle, sur le seuil du réel et de la fiction, entre les images et les choses. L’époque est à la foire aux atrocités qui est une farce carnavalesque dont les puissances d’inversion et de subversion peuvent être cependant réelles. L’ours est l’animal totémique du carnaval et sa tradition. L’ours revient, éternel retour. Cela, l’anarchiste Alan Moore l’a su assez tôt quand, entre 1978 et 1979, il a animé une rubrique du journal contre-culturel d’Oxford, le Back Street Bugle, avec une parodie de l’ours Paddington intitulée Saint Pancras Panda. Et Damon Lindelof ne l’ignore pas davantage quand on remarque tous les plantigrades qui fréquentent ses séries, ours blancs sur l’île de Lost et ours à la une du fameux numéro 141 du National Geographic de mai 1972 dans The Leftovers.
Dans les rangs des policiers de Tulsa, celui qui tient le plus au respect de la loi et son code se fait appeler Panda. Le masque qui recouvre sa tête est une peluche amochée comme revenue du temps oublié de son enfance. Le masque relève du joujou et son rappel devrait rappeler aux adultes qui se prennent au sérieux que le masque qui recouvre leur tête ressemble à un ballon de baudruche, qui enfle et gonfle jusqu’à l’asphyxie et l’explosion.
Avec le masque, on n’en finit pas, on n’en finira jamais de balancer selon ses effets de parallaxe. Dylan Thomas est un poète d'origine galloise dont l’amitié nous importe ici. On retient ici qu’il a écrit ses poèmes en sachant occuper la place de l’autre qui n’est pas là, l’enfant jamais connu qu’ont perdu ses parents (« Moi le premier né / Je suis le fantôme de cet / ami anonyme, sans prénom / qui écris les mots que j’écris »). Sa poésie pour nous en indique le tic-tac parallactique : tic (« Ô fais-moi masque et mur pour m’abriter des espions »), tac (« Aime-moi et soulève ton masque »).
IV. L’amour, un don divin
pour ne pas être un dieu
L’amour est l’imprévisible, l’amour est une figure de l’impossible. L’amour est plus qu’un supplément, c’est l’exception à l’ordinaire des situations qui arrive dans la vie de ceux qui, malgré les difficultés et dans l’épreuve propre à toute novation, se destinent fidèlement à en expérimenter les conséquences dans la construction d’un site, l’élaboration d’une scène nouvelle. La scène de l’amour est celle d’une différence constructible, à la fois conjonctive et disjonctive, en tenant pour l’un de ses sujets du deux et rien que le deux et pour l’autre du deux pour autant qu’il tienne de l’entre-deux. Nous pensons à la suite d’Alain Badiou que l’amour est une condition pour penser ce que l’événement veut dire et l’amour est tel dans les séries de Damon Lindelof, absolument.
L’amour est l’événement auquel on peut tenter de mesurer à la fois le sens des séries de Damon Lindelof (le sens qui résiste à la signifiance qu’il rend possible est l’insensé, le sens qui reste comme restance) et, distinctement, leur vérité (l’insensé qu’il faut pourtant affronter afin d’en tirer une orientation nouvelle exige une éthique assomptive et soustractive, le partage d’une croyance qui n’est pas une volonté de savoir, un secret qui est un silence).
Pour apprécier la valeur d’événement chez Damon Lindelof, il faut considérer l’amour en mettant en rapport ses puissances sidérales avec les autres événements qui arrivent dans Lost, The Leftovers et Watchmen. Et qui, eu égard à ce rapport, se révèlent des événements de moindre consistance quand ils ne se révèlent pas inauthentiques, en dépit de leur pouvoir de sidération. Dans Lost, l’amour est le destin de trois couples magnifiques, Jin et Sun, Bernard et Rose, Desmond et Penny, qui débordent largement le trio plus conventionnel formé par Jack, Kate et Sawyer. Leur amour est plus sûrement un événement que la chute pourtant extraordinaire des personnages sur l’île mystérieuse qui, en dernière instance, ressortit du plan de Jacob. L’événement n’est pas dans Lost le produit longtemps caché du calcul délibéré d’un gardien qui travaille à la succession de l’omphalos du monde, mais le fait que les héros élus par Jacob décident d’assumer, pour chacun différemment et toujours singulièrement, les conséquences éthiques d’une élection d’abord vécue comme un arrachement.

Dans la variété constellée des positions adoptées par les personnages se distinguent les amours de Penny et Desmond, de Rose et Bernard et de Sun et Jin, qui scintillent dans le ciel de Lost avec la même force que l’étoile du matin. L'étoile du berger dont l'un des gardiens est le chien Vince, adopté parmi tous les adoptés peuplant en abondance les séries de Damon Lindelof. Pour les amoureux qui s'entre-adoptent en préférant l'adoption à l'adaptation, Vénus est une boussole quand l’époque est aux dérives tectoniques de la désorientation.
Dans The Leftovers, la « Soudaine Disparition » tiendrait de toute évidence de l’événement. C’est un surgissement d’abîme imprévisible et imprédictible, une trouée de réel qui aspire comme un vortex toutes les explications en étant le foyer incandescent et risqué de leur possibilité. Mais l’événement reste en soi obscur, l’insensé même qui est la condition traumatique du sens tout en attendant qu’on en hasarde les conséquences dans la construction d’un site neuf, celui d’une vérité valable universellement. La disparition simultanée de 140 millions de personnes de par le monde est un réel dont la puissance traumatique est planétaire. L’accident originaire qui attend sa contre-effectuation, un langage et des énoncés, des sujets et la construction d’une différence, c’est cela l’événement. La puissance d’éclaircie appartient en particulier à ceux qui se retiennent de tomber dans le puits obscur de l’événement pour préférer le contempler en restant sur sa margelle. Les bords où ils peuvent accueillir l’accident en le contre-effectuant comme événement indiquent qu’après le puits il y a un pont, celui de l’amour qu’il faut essayer encore et encore, qu’il faut rater encore pour rater mieux comme Samuel Beckett l’écrit dans Cap au pire (1983).
Dans The Leftovers, l’amour est l’événement qu’incarnent Nora Durst et Kevin Garvey. Et, après bien des échecs et bien des années, le temps ayant déposé dans la chevelure de l’une des sels d’argent et dans le cœur de l’autre un pacemaker, ils en trouvent le site toujours plus loin en descendant dans le sud, en Australie, qui rappelle à l’amour que son soleil est une utopie concrète – terra australis incognita.
Il y a une histoire d’amour dans Watchmen et elle est sublime. On ne s’en étonne pas quand on a vu et aimé les précédentes séries de Damon Lindelof. Et, en même temps, on s’en étonne encore parce que l’amour est une nouvelle fois saisi avec cette force d’étonnement qui, pour Socrate, qualifie déjà le geste philosophique même. C’est que l’amour a la force de foudroiement de l’éclair, une force de fracas comme le crâne de Zeus fracturé par Athéna. Cela, la série l’invente pour son propre compte sans en hériter ou si peu du comic book d’Alan Moore. C’est l’une des régions de Watchmen la série où, intensément, brille le génie démonique de son narrateur parce que l’amour est un démon quand il invite un dieu à laisser tomber le statut de divinité qu’on lui demande incessamment d’adopter dans la préférence divine de l’amour caché.
L’amour caché est un abri des cœurs dont le secret vaut mieux qu’un dieu caché.
Le Docteur Manhattan, on l’a dit, est un dieu créole. Chez lui convergent restes de mythologie grecque (Angela compare d’emblée sa technique de drague à celle de Zeus et c’est sur Europe, une des lunes de Jupiter, qu’il crée la bulle d’un paradis factice) et recyclage pop du premier prophète du judaïsme (Superman en Moïse de la culture de masse, antinazi et impérialiste), bouddhisme zen à l’heure atomique (la représentation probabiliste de l’atome d’hydrogène sur son front ressemble à l’urna) et christianisme dans sa version tardive, hétérodoxe et gnostique (le dieu caché est un mauvais démiurge pour ses créatures abandonnées sur Europe et il ressemble comme un frère au Jésus amoureux de Marie-Madeleine dans l’Évangile apocryphe de Judas).
Avec le seul détenteur de super-pouvoirs, le monothéisme se réinvente aux couleurs bariolées d’une panique néo-païenne et de l’apocalypse judéo-chrétienne. Le Docteur Manhattan est un carnaval créole à lui tout seul. C’est pourquoi le guette le danger kitsch du New Age, même repeint de gnosticisme pop.
Si le Docteur Manhattan est bleu, il l’est sûrement aussi parce que le dieu est fleur bleue, moins laitue que cœur d’artichaut. On se souvient en effet qu’il a aimé Janey Slater puis Laurie Jupiter dans la BD, avant de s’offrir à l’amour d’Angela Abar dans la série. Et d’une certaine façon, d’en mourir parce que la mort est consentie en devenant un destin, celui de redevenir un être humain.
Fleur bleue : le motif cher au romantisme de Novalis est celui de l’absolu dont l’idéal aura vite été meurtri par le destin kitsch anticipé par Heinrich Heine en poésie (c’est la hantise d’une irrésolution qui travaille les films de David Lynch). Les ambivalences du bleu quand le blues est aussi celui des policiers qui en ont adopté la couleur sont ce dont hérite le Docteur Manhattan qui, trente ans après, est encore attendu comme le Messie quand il aura surtout servi d’arme de destruction massive pendant la Guerre du Vietnam. C’est pourquoi il incarne, après Jacob et tant d’autres personnages de Damon Lindelof, celui qui déçoit en risquant, avec la trahison des aspirations des autres, le retour de bâton d’un ressentiment qui est une volonté de néant apocalyptique. Le dieu qui se refuse à l’être n’oublie pas cependant que la modernité est l’époque où, avec le reflux du divin, le monstrueux apparaît (né Jon Osterman, il est un être humain victime d’un accident nucléaire et il est qualifié d’être extraordinaire en référence au bossu de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo). Le Docteur Manhattan met pourtant un terme à son indifférence souveraine entretenue durant son exil sur Mars quand, un jour de 2009, il revient sur Terre pour déclarer dans un bar de Saïgon son amour à Angela. C’est alors que les difficultés commencent.
Comment, en effet, l’amour pourrait-il advenir au Docteur Manhattan ? Comment l’amour pourrait-il être un événement pour lui qui est omniscient, simultanément présent à tous les instants de sa ligne de temps ? Le Docteur Manhattan agace ses amoureuses, c’est connu, parce qu’il voit tout en sachant tout de ce qui lui arrive et va lui arriver puisque tout lui est de toute façon toujours déjà arrivé. L’omnivoyant est le sujet inhumain d’un rapport au temps que l’on pourrait qualifier de bergsonisme ou d’augustinisme poussé à l’extrême parce qu’il est un monstre pour qui le présent du présent est autant celui du passé que celui de l’avenir. Rien n’arrive au Docteur Manhattan parce que ses super-pouvoirs l’immunisent contre l’imprévisible.
Le déterminisme s’impose en effet comme un fatalisme pour celui qui a perdu de vue ce qu’est un événement. Avec lui, chronos se confond avec aiôn en ayant fait de kairos une bouchée. Comment, alors, pourrait-il être le sujet d’un événement ? Il le peut pourtant quand il cesse d’être un héros surpuissant pour redevenir celui qui, comme le dirait Giorgio Agamben, peut son impuissance. Cela, il le peut dans l’amour pour Angela en consentant à l’oubli. Une chanson en livre la métaphore qui est le secret des amoureux : « The Tunnel of Love » chanté par Doris Day dans le film éponyme de Gene Kelly en 1958. Avec l’oubli qui est une amnésie décidée et consentie, le temps qui vient est celui du secret des amoureux à qui appartient la construction d’une scène du deux, rien qu’à eux. Et c’est une ellipse, une réserve de hors-champ que ne trahira jamais la série (à la seule et unique exception du flash-back de la nuit blanche de Noël 2016 où l’inconscient du dieu caché a permis de sauver Angela de l’assaut meurtrier des fachos).
L’amour est une zone de non connaissance qui se partage moins qu’elle partage ses sujets. C’est une soustraction à toute volonté de savoir car l’amour ne veut rien mais laisse être, passivité essentielle avant d’en construire les conséquences fidèles. L’amour est un secret comme la nudité qui défend ce qu’elle expose et c’est un mystère dont l’initiation se fait dans le silence des amoureux. L’amour est le désir d’une puissance qui ne se consomme ni ne s’épuise dans ses actes parce qu’elle demeure une puissance – c’est une puissance suprême quand elle se maintient comme puissance. Voilà l’événement désiré par le Docteur Manhattan en acceptant de se soustraire à ses propres pouvoirs et son impuissance est trahie par ceux qui rivalisent pour mettre la main sur ce que le quasi-dieu a le pouvoir de faire alors qu’il reste dans nos cœurs celui qui a choisi avec l’oubli de ne pas faire.
Effet de parallaxe de l’amour qui fait voir toute la puissance qu’il y a dans l’impuissance en rouvrant la possibilité de l’indéterminé malgré tout déterminisme. L’éternel retour est un écart parallactique qui soustrait de tout fatum un amor fati. L’éternel retour est celui de l’événement dont l’amour est l’une des figures privilégiées.
Il faut s’emplir de l’émotion qui vient briser l’indifférence du dieu revenu à lui-même avant de mourir quand il voit Angela se saisir de ses armes afin de défendre l’homme qu’elle aime. Pour le dieu revenu à lui-même, à nouveau tout est joué. Pour elle qui n’aime pas un dieu mais un homme, tout reste encore possible. Voilà l’écart parallactique et il est si décisif qu’il fait écho à Cesare Pavese et ses Dialogues avec Leuco (1947). Quand l’écrivain italien note que « L’homme mortel n’a que cela d’immortel. Le souvenir qu’il emporte et le souvenir qu’il laisse », il est difficile de ne pas penser au Docteur Manhattan. Le possible est celui qu’épuise l’horreur d’une modernité apocalyptique et sa relance est l’impossible même dont le philosophe Frédéric Neyrat dit aujourd’hui qu’il est une merveille. Qu’un quasi-dieu ait préféré à ses pouvoirs surhumains l’impuissance d’être un homme, rien qu’un homme qui aime, est une chose divine : c’est une merveille. Et les amoureux merveilleux sont comme des saints. Alors, dans le passage du dieu caché à l’amour caché, il y a la possibilité d’une vérité athéologique : Dieu nomme l’endroit où il fait défaut et ce que l’on trouve à la place où il manque est l’amour.
Pour accéder aux vérités de l’amour et de l’événement – à la vérité de l’amour comme événement – il faut pour Damon Lindelof procéder comme avant lui David Lynch, Jules Verne, Dante, Virgile, Platon, Homère en remontant même jusqu’à l’épopée de Gilgamesh : par catabase. Descendre devient transcendantal – une « transdescendance » comme le dit Gaston Bachelard dans La Terre et les rêveries du repos (1948). À la galerie de taupe creusée par les fascistes qui ont à la place du cœur l’horloge d’un détonateur, on est en droit de préférer le souterrain secret des amoureux comme une chanson d’amour, un « Tunnel of Love ».
Le paradis artificiel soufflé par le Docteur Manhattan sur Europe est un artefact de génie mais le génie est un démon. Un simulacre qui est le produit inconscient de la résistance du petit juif allemand à sa christianisation opérée par les aristocrates anglais qui ont offert à lui et à son père l’hospitalité avant la guerre. Et la copie s’engorge d’autres angoisses aussi, d’autres hantises à l’instar de la mort de masse que l’exil d’Adrian Veidt vérifie quand il est temps pour lui d’y mettre fin en rêvant peut-être au destin d’Edmond Dantès dans Le Comte de Monte-Cristo (1844) d’Alexandre Dumas. Comme le paradis est toujours déjà perdu, il ne reste plus qu’à accéder au royaume à venir dont les amoureux héritent moins qu’il leur faut en construire le site. C’était, hier, la poitrine ouverte accueillant le cœur blessé d’un nouveau Roi pêcheur et Kevin Garvey a alors besoin de se dédoubler pour dialoguer avec son double (la pensée est une conversation de soi avec soi – dianoia) et ainsi désobstruer la vérité enfouie en lui qui fait tout son malheur (« We fucked up with Nora »). C’est, aujourd’hui, la boucle glissée dans la tête du dieu amnésique qui se substitue à l’atome d’hydrogène et elle vaut bien mieux qu’un talon d’Achille saturé de tachyon : l’alliance est celle des amoureux. Comme l’île de Lost représente un bouchon pour la source de puissance qu’elle coiffe et retient, l’anneau est celui de l’oubli pour autant qu’il offre à un dieu le destin de redevenir humain.
Humain, seulement humain, autrement dit être disposé à la puissance comme impuissance, être ouvert à l’événement et en être digne, être destiné à l’impossible qui relance tous les possibles.
Déduit de l’omniscience du Docteur Manhattan, le cercle des prophéties auto-réalisatrices est un jeu de vases communicants à l’œuvre dans l’épisode huit quand il induit l’équivalence du flash-back et du flash-forward. Mais le cercle est une boucle qui ne se referme pas sur elle-même quand l’amour s’impose en expérimentant le deux comme un effet de parallaxe. L’éternel retour de l’événement est toujours celui dont on oublie les avatars comme en portent témoignage les traditions culturelles convergentes de l’orphisme et de l’anamnèse platonicienne, de la métempsycose et du saṃsāra. Tout est joué parce que tout ce qui se joue se rejoue et, pourtant, rien n’est joué, il faut y croire et persévérer, malgré l’abondance des non-dupes qui errent dans les dédales d’une culture saturée. Malgré le désamour même qui est la hantise apocalyptique des amoureux qui ne le sont plus et l’amour qui ravit moins qu’il a disparu est ce que doit affronter Laurie Blake quand elle découvre que l’homme qu’elle n’a pas cessé d’aimer depuis toutes ces années en aime une autre. Le réveil est dur, c’est comme une brique sur le crâne. Laurie s’y abandonne pourtant – l’amour fini est son amor fati – et son consentement est aussi émouvant que celui des amoureux qui persévèrent dans leur amour jusqu’au bout.
C’est pourquoi est si belle, projetée sur un mur jaune de Saïgon, l’ombre d’Angela et du Docteur Manhattan devenu Cal Abar. L’ombre n’est plus la trace des victimes de Hiroshima comme dans le comic book d’Alan Moore mais l’ombre de l’amour que voient Giorgio Agamben et Valeria Piazza, notamment à travers l’échange épistolaire entre Hannah Arendt et Martin Heidegger. Avec l’ombre de l’amour, l’ouverture de l’être est celle de son opacité. Avec l’ombre de l’amour, la vérité est rappelée à la garde de la non-vérité, la lumière à la sauvegarde de l’obscur, la mémoire à celle de l’oubli.
Une grande image de Watchmen, sûrement l’une des plus belles, est celle-ci : il faut qu’une femme fracasse le crâne de l’homme qu’elle aime pour lui rappeler qu’il avait été un dieu. L’oubli de dieu dévoile que l’amour est divin et la sainteté en auréole ses sujets. L’amour se pense ainsi comme la philosophie pour Nietzsche : c’est un réveil à coup de marteau. C’est Athéna qui naît en fracassant la tête de Zeus son père. L’événement peut alors répondre à la question que pose David Bowie dans Life on Mars ? revisité ici de manière somptueuse par Trent Reznor et Atticus Ross : y a-t-il une vie sur Mars ? Oui, sur Terre. C’est le secret d’un paradis caché dans le cœur des amoureux.
V. La meilleure série de 2019 est la meilleure série de 2020
(et la meilleure série de 2021 ?)
De toute évidence, Watchmen s’est imposé comme l’une des meilleures séries de 2019. On ne se serait cependant jamais douté qu’elle a été, plus encore et de loin, la meilleure série de l’année 2020.
« Comment s’en sortir sans sortir » : le titre d’un récital poétique de Ghérasim Luca donné à la télévision en 1988 aura été notre pierre d’orientation quand la pandémie de Covid-19 a entraîné comme mesure sanitaire le confinement généralisé de mars à mai. C’est alors que la série de Damon Lindelof est revenue à l’esprit, comme le souffle d’un esprit bienveillant, revenant encore et encore à chaque fois que l’actualité s’ingéniait à ouvrir un nouveau front à l’extension du désastre. L’amitié dont cette série aura pour nous témoignée consiste en effet à nous avoir accompagnés de son génie prophétique. En répétant l’aide primordiale de l’accompagnateur originel et en ouvrant notre chemin en dépit des embûches diversement semées à la possibilité de penser ce qui nous arrive et qui paraît de moins en moins pensable.
Nous ne sommes pas sorti-e-s de notre nuit fœtale et nous ne cessons pas d’être des nouveaux nouveau-nés. Mais la rupture des enveloppes se fait un cran plus difficile et la serre mondiale se montre toujours plus saturée des embrasements de l’auto-immunité, gonflée de cendres jusqu’à devenir irrespirable.
Vivre c’est respirer et respirer consiste à synchroniser nos souffles en inventant de nouvelles formes d’immunité, en participant à créer un communisme rénové qui se comprenne désormais comme un « co-immunisme » pour en reprendre l’idée à Slavoj Žižek qui l’a trouvée chez Peter Sloterdijk. Respirer recommence en particulier avec les œuvres qui ont l’amitié de nous aider à penser en pansant nos blessures qui, Will Reeves nous l’a redit, ont besoin d’air pour cicatriser.
On ne peut pas respirer, on voudrait respirer : c'est la prière laïque de notre époque asphyxiée. On pense évidemment aux maladies respiratoires causées par le coronavirus en obligeant les visages de la Terre entière à se recouvrir de masques amenuisant un peu plus la cordialité interfaciale sur laquelle repose toute civilité. Leur pénurie a par ailleurs dévoilé l’impéritie des gouvernements qui ont sacrifié l’offre publique de santé au nom des impératifs économiques du néolibéralisme. On a forcément une pensée pour Li Wenliang, lanceur d’alerte chinois décédé à Wuhan du virus en février. Et aussi à Cédric Chouviat et à George Floyd dont l’appel à l’aide a été un cri autrement étouffé par des policiers ayant abusé de leur mandat, à Paris en janvier et à Minneapolis en mai. Les gardiens de la paix se muent en protecteurs d’un État dont l’autoritarisme signe le discrédit. La sortie en septembre du documentaire de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, rappelle encore, malgré son désir d’analyse court-circuité par un registre émotionnel à l’estomac, que la colère des Gilets Jaunes relève moins du ressentiment que d’un désir populaire de justice sociale. Là-dessus il vaut mieux revoir Watchmen que le Joker (2019) de Todd Phillips. Surtout, leurs yeux éborgnés nous apparaissent désormais comme des œufs brisés par les flash-balls du cuisinier en chef qui se casse la tête en préparant ses omelettes jupitériennes.
« Quis custodiet ipsos custodes ? » demandait Juvénal. Alan Moore en a actualisé la citation et, aujourd'hui, Damon Lindelof repose à nouveaux frais la question. On répondrait avec Eugène Pottier et L’Internationale écrite il y a 150 ans, le grand âge de la si jeune Commune : « Il n’est pas de sauveurs suprêmes, / Ni Dieu, ni César, ni tribun, / Producteurs sauvons-nous nous-mêmes ! / Décrétons le salut commun ! ».
L’Internationale a été abondamment entonnée pendant les grandes manifestations populaires de décembre 2019 à février 2020 contre l’énième contre-réforme de l’assurance-retraite qui représente avec son principe de socialisation du salaire une forme réelle de co-immunisme. Les cortèges avaient alors le bariolage nécessaire à multiplier les masques et leur parade a participé à en faire tomber quelques-uns. Le carnaval pour inverser les valeurs en montrant que les masques ne sont pas là où l’on pense. La parodie pour indiquer ce qu’il y a de réellement insupportable dans les fictions du gouvernement. L’un de ses porte-paroles, Jean-Paul Delevoye, a d’ailleurs été désavoué en raison de conflits d’intérêt, lié à un think tank répondant au nom de Parallax, ce qui est parfait.
On ne peut pas respirer, on voudrait respirer : c'est la prière laïque de notre époque asphyxiée. Forêts réduites en cendre, poumons verts cramés, terres brûlées : partout la Terre flambe, Afrique du sud, Amazonie, Australie, Californie et les pompiers se révèlent quelquefois des pyromanes. « Quis custodiet ipsos custodes ? », encore et encore. Le 4 août, le port de Beyrouth, centrifugeuse quantique doublée d'une bombe à retardement, explose en provoquant la mort de plus de 600 personnes. Le lendemain, à Épineuil-le-Fleuriel, le philosophe Bernard Stiegler se donne la mort. Le 16 octobre, le professeur d’histoire-géographie Samuel Paty est décapité à Conflans-Sainte-Honorine par un fanatique. C’est un choc traumatique de portée nationale qui s’inscrit dans la pire série d’actes terroristes commis en France depuis 2015. Ces faits sont très différents mais ils convergent cependant en tissant une constellation obscure de symptômes pour la dystopie concrète du maintenant.
2020, annus horribilis. Retrouver l’étonnement est difficile mais c’est ainsi que l’on pourra renouer avec la pensée pour respirer. Même si la Terre est une sphère qui, entre une explosion, un incendie et une implosion, perd toujours plus la boule en s’enfonçant dans l’irrespirable, se dissolvant dans l’écume des passions apocalyptiques. Penser ce qui nous arrive pour panser nos blessures c’est tenter d’en tirer un destin. Malgré le suicide des penseurs qui nous rappellent pourtant, à la manière inaugurale de Socrate, que la vie qui vaut la peine d’être vécue n’en reste pas moins une maladie.
Penser à la potentialité d’une sortie, c’est penser la possibilité d’une percée. Comme avec la fin de la présidence Trump aux États-Unis qui a incarné la connivence au plus haut sommet de l’État des représentants en vogue de l’« alt-right » avec les vieux épiciers du fascisme comme le KKK. On se surprend à voir l’intime ressemblance de la vice-présidente du nouveau chef de l’État le démocrate Joe Biden, la métisse Kamala Harris, avec le personnage d’Angela Abar. Même créolité, même féminité offensive, mêmes contradictions entre progressisme et autoritarisme. Les États-Unis demeurent une nation à la croisée des chemins, bandes alternées rouges et blanches de démocratie inventive et de mentalité obsidionale, de repli sur soi et d’ouverture au monde. Watchmen aura à sa façon, diagonalement, proposé son commentaire anticipant le sort des élections présidentielles.
Avec l’actualité étasunienne on a repris notre souffle mais, soudain, on respire à nouveau un peu moins quand les rengaines rances du séparatisme et de l’islamo-gauchisme étouffent la voix des opprimés de la race. Et on s’étouffe carrément quand la loi dite « sécurité globale » est sur le point d’être adoptée en continuant de mettre en difficulté les praticiens d’une liberté d’informer qui devrait savoir s’arrêter là où commence la protection des policiers. De l’immunité à l’impunité et de l’impunité à l’auto-immunité, il n'y aurait qu'un pas, moins d’un pas, différence infra-mince. Un effet de parallaxe, celui du pharmakon, celui des poisons dont on tire des remèdes et des remèdes qui virent en addiction toxique.
2021, annus mirabilis, on se l’était juré. C’est un paradoxe difficile à assumer que celui de s’avouer que Watchmen risque encore, pour le meilleur et pour le pire, d’être la série de l’année. On est mal barré, peut-être, mais on ne manquera pas d’air quand il s’agira de se faire voir ailleurs, toujours à l’endroit où l’on n’est pas. Même sur place. Alors on nomadisera avec la pharmacie de la série. Écart parallactique aux effets pharmacologiques : se désaxer pour changer de place et pouvoir ainsi renouveler notre regard, penser pour panser. Par exemple en revoyant, à l’heure où les salles de cinéma restent toujours fermées et où l’on nous promet un nouveau confinement, une série télé aimée comme une grande œuvre de pensée, pour aimer, vivre et respirer. Et nous voir comme on la regarde, en se disant réciproquement : « Aime-moi et soulève ton masque ».
Poursuivre la lecture autour de Damon Lindelof
- Des Nouvelles du Front, « Humanité restante, penser l’événement avec la série The Leftovers », Le Rayon Vert, 25 décembre 2018.
